
Dans le dernier numéro de Philosophie Magazine, Miguel Benassayag, s’instituant spécialiste de Spinoza, nous livre ses interprétations. En relation avec ses expériences…
Je viens de finir.
Il se trompe beaucoup et confond l’état d’esprit avec l’affirmation péremptoire et ramène Spinoza à un charlatan du développement personnel.
Je colle ci-dessous l’article (en vous conseillant de vous abonner à la revue)
Je reviendrai très bientôt pour écrire pourquoi il se trompe lourdement sur le maître.
Il s’agit, en vérité, de la question de l’approche philosophique et ses succédanés. Miguel, tout en critiquant les grecs, se place dans la “philosophie-sagesse” qui est au fondement de cette déviation thérapeutique.
Spinoza n’est ni un marchand de bonheur, ni un précurseur de la psychanalyse et, encore moins, un sage. C’est juste un philosophe….
Et l’expérience est antinomique d’une théorie philosophique, sauf à redevenir le collégien qui clame “carpe diem” entre deux parties de baby-foot.
Miguel fait état de “supermarché”. Il se peut qu’il y trouve une bonne place dans celui de la pensée.
En l’état je laisse lire et, éventuellement, apprécier…
Je perturbe un peu la lecture en soulignant ce que dois commenter….
Spinoza vu par Miguel Benasayag
Miguel Benasayag : “Spinoza m’a fait comprendre que le corps est indissociable de la pensée”
Spinoza est le compagnon de route de Miguel Benasayag. Aussi bien dans son engagement contre la dictature militaire en Argentine que dans sa pratique de psychanalyste ou dans sa position contre la conception du vivant du transhumanisme et des neurosciences, il s’inspire de l’auteur de l’“Éthique” et dénonce le retour du dualisme qui isole l’esprit.
Miguel Benasayag
Philosophe et psychanalyste, il est l’auteur, entre autres, de Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale (avec Gérard Schmit, La Découverte, 2003), d’un Abécédaire de l’engagement (Bayard, 2004), d’un Éloge du conflit (avec Angélique Del Rey, La Découverte, 2007) et de plusieurs ouvrages consacrés à la bioéthique : Cerveau augmenté, homme diminué (La Découverte, 2016), La Singularité du vivant (Le Pommier, 2017), Fonctionner ou Exister ? (Le Pommier, 2018).
« Il me paraît essentiel de revenir à Spinoza et à sa pensée du corps, car nous glissons aujourd’hui sur une pente dangereuse. Contrairement à toute une tradition philosophique qui va de Platon à Descartes, Spinoza ne sépare pas l’âme du corps mais en fait une seule et même chose, il s’agit pour lui des deux attributs d’une même substance. “L’Âme et le Corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous l’attribut de la Pensée, tantôt sous celui de l’Étendue”, écrit-il dans l’Éthique. Or, depuis une trentaine d’années, on a tendance, en biologie et en robotique, à revenir au dualisme platonicien. Dans la recherche scientifique, tout s’oriente désormais vers le dépassement du corps comme s’il n’était qu’un simple support matériel. Le transhumanisme n’est qu’une version du platonisme, sans le génie de Platon, avec cette idée que le corps est un simulacre, que la vraie vie est celle des idées, des archétypes, et que le monde physique est une prison, la caverne, dont on doit s’échapper. Dans le langage scientifique, cela se traduit par l’idée que la vérité se trouve dans l’algorithme, que tout n’est qu’information. Le transhumanisme promet une augmentation du corps, mais il s’appuie surtout sur l’idée de la singularité, du pivot à partir duquel la vie n’aura plus besoin d’un corps biologique. On en vient à ignorer certains invariants corporels, biologiques, ce qui risque de mettre en danger la vie, le vivant. L’un de ces invariants tient aux limites que les transhumanistes considèrent comme des bornes à dépasser. Or les corps existent uniquement parce qu’ils sont limités. La singularité du vivant repose sur la contingence, le non-savoir, le non-prédictible, et sur une dimension de négativité irréductible à l’utilité, au fonctionnement et à la calculabilité.
Le modèle du vivant, de la vie artificielle aujourd’hui dominant, considère que la modélisation numérique peut épuiser l’ensemble du réel. La numérisation suppose que le réel puisse être modélisé comme un ensemble de points. C’est ce qu’on appelle l’arrondi digital : je considère comme un point ce qui existe en réalité comme intervalle. La modélisation numérique est intéressante si on la conçoit seulement comme une autre dimension de la vie, qui peut s’articuler, sans les écraser, avec les processus organiques. Depuis l’affirmation du biologiste Jean-Pierre Changeux selon laquelle “on peut abolir la frontière entre le mental et le neural”, on considère en France que le cerveau fonctionne comme une machine. Changeux ajoute à cela que le neural fonctionne comme une chaîne algorithmique, qu’on peut tout réduire à des algorithmes. Spinoza constate, lui, qu’“on ne peut pas savoir ce que peut un corps”. Ce non-savoir marque la non-réduction d’un attribut à l’autre, de l’étendue à la pensée, il implique qu’il n’est pas possible de réduire l’un à l’autre. Pour parler en termes spinozistes, nous dirons ainsi qu’il ne peut y avoir de distinction numérique dans la substance.
En quoi ce réductionnisme est-il dangereux ? Parce qu’il conduit, par exemple, à traiter le corps, le cerveau des enfants, comme s’ils étaient des machines dans lesquelles on peut implanter ou enlever un certain nombre de logiciels. Un exemple très clair de ce raisonnement a été mis en évidence par Angélique Del Rey dans son travail sur la pédagogie des compétences qui se concentre sur les formes de l’apprentissage, et non sur les contenus – il s’agit en quelque sorte d’apprendre à apprendre. Les neuroscientifiques présents dans le Conseil scientifique mis en place par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer vont à mon avis dans ce sens. Ils visent d’abord le “disque dur”, le cerveau de l’enfant, et, pour les “logiciels”, on verra après. Comme pour une machine numérique, on veille à son bon fonctionnement. Mais les apprentissages en deviennent secondaires. Cela implique une dichotomie cartésienne entre corps et esprit. Mais si nous pensons en termes monistes spinozistes, nous voyons bien que le contenu ne peut pas être séparé du fonctionnement du cerveau.
Cette idée de traiter le vivant comme une table rase que l’on module à l’envi est très dangereuse. D’ailleurs, elle est constamment mise en échec. Si le vivant n’était qu’information modélisable numériquement, cela fait longtemps que nous serions parvenus à fabriquer une véritable intelligence artificielle. On peut envoyer un homme sur la Lune, mais on n’arrive pas à éliminer la grippe ! Le vivant et la culture ont une complexité non réductible au symbolique. Le problème vient surtout de l’idéologie qui sous-tend la possibilité de numériser tout le vivant. N’importe quel scientifique sait que c’est un échec, mais cette idéologie a des conséquences concrètes, pratiques. On traite l’éducation, la société, l’économie, comme si le réel pouvait se réduire à des unités discontinues modélisables. Cet objectif est non seulement inatteignable, mais aussi dangereux pour le vivant. »
« Ma sensibilité au rapport entre le corps et l’esprit tient à mon parcours et à mon expérience des chambres de tortures pendant la dictature militaire en Argentine dans les années 1970. J’ai eu la chance – je dis bien la chance – de ne pas parler sous la torture. C’est de la chance, parce que si mes tortionnaires avaient continué un jour de plus, j’aurais peut-être craqué. Tenir n’est pas du tout une question de courage ou de morale. Une fois en prison, j’ai décidé de m’occuper des camarades qui, eux, avaient tout balancé, leurs amis, leur copine, et qui, de ce fait, étaient démolis, rendus presque fous. Ceux-là arrivaient comme mentalement démembrés, c’était horrible à voir. Ils ne pouvaient plus parler, plus penser. Avant de passer par la torture et les aveux, ils avaient leur opinion sur les choses. Mais une fois leur corps brisé par la douleur, ils ne pouvaient plus rien affirmer, ils étaient incapables d’être clairs politiquement et philosophiquement. Ils ne pouvaient même plus dire : “Je suis contre la dictature.” S’occuper de ces camarades pouvait s’avérer très dangereux : après tout, ils pouvaient très bien balancer ce que nous faisions en prison, nos plans d’évasion ou ma véritable identité que j’étais parvenu à cacher. Mais je refusais la moralisation de tout cela. Le bien et le mal ne sont pas des catégories absolues chez Spinoza : cela m’a permis de voir que ces camarades méritaient de l’attention, bien qu’ils aient flanché. Parmi eux, je me souviens de deux médecins à qui je demandais parfois conseil : même sur un plan strictement médical, ils étaient incapables de mobiliser leurs connaissances. Tout était anéanti, y compris leur savoir technique. C’est là, en prison, que j’ai vraiment interrogé ce rapport entre le corps en situation et la pensée, qui fait qu’on ne pense pas de la même manière selon que notre corps va bien ou est détruit. Spinoza m’a beaucoup aidé à comprendre pourquoi ces corps détruits ne pouvaient plus produire certaines idées, ne pouvaient plus s’exprimer : tout simplement parce qu’il existe une correspondance entre le corps et la pensée.
Dans ma pratique actuelle de clinicien et de psychanalyste, j’essaie de prendre en compte cela en orientant la thérapie vers l’exploration des possibles du corps du patient. “Quels sont mes possibles ?”, doit se demander le patient, et non pas “Quels sont tous les possibles ?”, comme s’il s’agissait de choisir une vie parmi d’autres dans les rayons d’un supermarché. Certains patients vivent dans l’idée qu’ils pourraient être autres : c’est le cas de celui ou celle qui continue de dire, même à 40 ou à 50 ans passés, “ma mère est comme ci, mon père comme ça, je ne peux donc pas faire autrement”, supposant ainsi qu’une cause extérieure l’empêche soi-disant d’être lui ou elle-même. Avec cette idée de cause extérieure, ce patient garde l’illusion d’une liberté qui pourrait mener à une vie autre. Là encore Spinoza est pertinent lorsqu’il nous invite à agir sur nos passions, à connaître ce qui nous détermine. Il ne s’agit pas toutefois pour lui de nous rendre libres, mais seulement d’augmenter notre puissance d’agir par la connaissance des causes qui nous déterminent et ainsi de développer la joie plutôt que la tristesse.
Je me souviens d’une patiente issue d’une prestigieuse école de commerce, major de promotion, devenue cadre supérieure dans une grande entreprise pharmaceutique. Cela ne l’empêchait pas d’aller très mal. Dans un premier temps, elle me demandait comment faire pour être ce cadre sup parfait, sans souffrir. À ce moment de la thérapie, elle se plaignait beaucoup de ce qui la constituait, de sa famille, de sa mère, de son père. Elle vivait dans l’illusion qu’être libre revenait à devenir autre. Par un long travail, elle est finalement parvenue à se demander quel désir se cachait sous ce désir d’être autre, quels étaient ses possibles à elle. Il y a eu comme un atterrissage en elle. Certes, l’insatisfaction était toujours présente, mais ce n’était plus une insatisfaction qui conduit à dire : “Je pourrais être un Martien si je le voulais.” Étant donné ce que je suis, quels sont mes possibles ? Voilà la vraie question. Nous vivons dans un exosquelette constitué par les attentes de notre milieu social, de notre famille, mais il faut développer son endosquelette et, avant cela, apprendre à le connaître. Un jour de bascule de sa thérapie dont je me souviens encore, la jeune femme m’a dit : “Miguel, et si mon endosquelette n’en vaut pas la peine, ne vaut rien ?” Je lui ai répondu que c’était possible, mais qu’il y avait seulement deux solutions : “Soit on cherche cet endosquelette pour que vous puissiez vivre votre vie, soit vous restez à souffrir dans une vie qui n’est pas la vôtre.” Elle a eu le courage de partir à la découverte de cet endosquelette, ce qui l’a menée à s’inscrire en fac de lettres, puis en médecine et en psychiatrie, et elle est en train de terminer ses études. Elle, située d’une certaine façon, dans un certain milieu, la fille de ses parents, s’est mise à explorer, avec son corps à elle, ce qui faisait partie de ses possibles.
Cette exploration demande d’autant plus de courage que nous vivons dans un monde globalement dominé par ce que Spinoza nomme les “passions tristes”, soit la haine, l’envie, la colère, la peur, la honte. “Avoir quelqu’un en haine, c’est imaginer quelqu’un comme cause de Tristesse ; et par suite qui a quelqu’un en haine s’efforcera de l’éloigner ou de le détruire”, écrit-il. Difficile de ne pas penser au sort que nous réservons aux étrangers et aux migrants. Pour Spinoza, la Tristesse diminue notre puissance d’agir, elle est le signe d’une moins grande perfection. Elle alimente pourtant la plupart des programmes politiques qui l’emportent actuellement à travers le monde. Résultat : nous sommes de plus en plus disloqués, entre nous et à l’intérieur de nous-mêmes. Les candidats aux élections ne parlent plus du commun mais s’adressent à des individus sérialisés : “Tu paieras moins d’impôts, tu auras ceci, et toi cela.” Nous vivons dans une société dans laquelle, le lien se délitant, on ne peut que pâtir. Partout dans le monde, la droite dure l’emporte, y compris dernièrement au Brésil, ce qui est un événement historique fondamental. De même, en Argentine, depuis l’instauration des élections libres, jamais la droite n’avait gagné. La peur du futur, la fin du mythe du progrès, de l’idée que nous poursuivons un but qui nous rendra forcément meilleurs, ont opéré un changement énorme : nous sommes passés d’un futur-promesse à un futur-menace. Il y a cinquante ans, on croyait encore que futur rimait avec promesse, que tout irait mieux demain. Mais aujourd’hui, le futur apparaît comme une menace, il n’y a plus cette idée téléologique du progrès. Au lieu de l’idéal d’un progrès commun, désormais prime plutôt le désir de jouir de sa propre identité. Tout se recentre sur la notion d’identité fermée, saturée, qui nous dissout – “moi je suis blanc, toi tu es noir”. Tant que n’émerge pas un autre imaginaire, on peut toujours résister, il le faut, mais nous sommes dans une période obscure qui n’a pas encore touché le fond. Pour le moment, nous n’avons pas d’imaginaire alternatif qui nous dise comment envisager l’avenir autrement que saturé de menaces et d’angoisses. »
Découvrir la joie de l’agir
« Je ne crois pas toutefois qu’il faille se laisser contaminer par cette négativité. Permettez-moi de revenir à mes histoires d’ancien combattant : quand je suis entré dans la résistance, si j’avais pensé à la torture, à la disparition, à la mort, je n’aurais rien fait ! Il faut donc pouvoir mettre de côté la question : “Vers où tout cela nous mène-t-il ?” Avec Spinoza, il faut être plus immanentiste et se demander ce qu’il faut faire ici et maintenant. Spinoza nous invite à nous méfier d’un certain type de raisonnement, celui qui consiste à dire “cela s’est produit en vue de telle chose”. Pour lui, les causes finales sont des “fictions humaines” qui “renversent la nature” : si nous disons par exemple d’une tuile qui tombe d’un toit qu’elle le fait en vue de blesser la personne qui passe en dessous, nous négligeons les facteurs de gravité et de hasard. S’en remettre aux causes finales revient à se réfugier dans “l’asile de l’ignorance”, quand les idées adéquates peuvent guider notre action de façon non certaine, mais plus juste. Dans mon cas, j’ai donc refusé de penser à la menace pour déployer la joie de l’agir.
Spinoza ne nous facilite cependant pas la tâche en refusant d’essentialiser les catégories de bien et de mal : il définit le bien comme ce que nous considérons comme bon et le mal comme ce que nous considérons comme mauvais non pas de façon subjective mais pour et par des situations concrètes. “Bon et mauvais se disent en un sens purement relatif, une seule et même chose pouvant être appelée bonne et mauvaise suivant l’aspect sous lequel on la considère”, écrit-il dans le Traité de la réforme de l’entendement. Cela ne signifie pas que le bien et le mal sont inopérants, seulement qu’ils ne sont pas absolus. Cela marque le besoin d’une certaine prudence dans l’agir : il faut agir, mais en conformité avec l’idée adéquate, qui contient une prudence liée à un non-savoir. Pour mon groupe de résistance, j’ai écrit un document qui m’a valu sanction : je défendais l’idée qu’il fallait résister, nous révolter, prendre les armes, mais sans y croire. J’étais un peu anarchiste, un peu hippie, je n’aimais pas particulièrement les armes, et je me retrouvais avec tout un tas de personnes assez enclines à la violence. C’est par ailleurs le propre de tous les partis marxistes-léninistes de croire qu’ils possèdent une vérité qui éliminerait l’aléatoire. Je voulais seulement rappeler qu’il faut agir, mais sans la croyance absolue et certaine de faire le bien. Car on n’a jamais une certitude finie des conséquences de nos actes.
Longtemps après avoir écrit ce texte j’ai finalement trouvé chez Spinoza l’explication théorique de ce qui restait alors pour moi une intuition. Spinoza établit une différence entre l’expression et la révélation. La substance s’exprime à travers les modes. Ainsi Dieu n’interdit pas à Adam de manger la pomme mais lui donne la possibilité de comprendre que celle-ci composera mal avec son corps. Au cœur de l’expression se trouve un principe d’immanence. En revanche, dans la révélation, un leader, un chef charismatique, une avant-garde, relèveront le bien et le mal, le juste et l’injuste, les bonnes causes et les ennemis à abattre. À nous d’obéir ou non en cédant alors à une pure dynamique de transcendance, au-delà de toute situation concrète. Nous n’avons nul besoin pour agir d’attendre le maître libérateur ou l’homme providentiel qui prétendraient nous révéler le chemin téléologique de la vérité et de la justice avec un programme et un monde à la clé. Dans une époque obscure, l’engagement immanent apparaît plus que jamais comme une proposition d’émancipation. »
Propos recueillis par Victorine de Oliveira






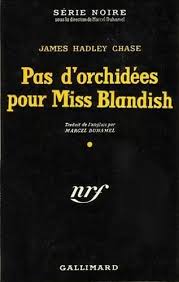 Le temps est donc, comme souvent lorsque le dernier bouquin vous tombe des mains, à la relecture. Il faut toujours relire. Ca nous fait voyager dans une vie. La sienne évidemment. La bibliothèque dans sa liseuse ou sa tablette est, pour ce faire, prodigieusement au point.
Le temps est donc, comme souvent lorsque le dernier bouquin vous tombe des mains, à la relecture. Il faut toujours relire. Ca nous fait voyager dans une vie. La sienne évidemment. La bibliothèque dans sa liseuse ou sa tablette est, pour ce faire, prodigieusement au point.












 La soirée s’annonçait bien, tous souriaient, allez savoir pourquoi. De fait la soirée se déroulait bien. L’un des invités proposa un jeu. Il s’agissait, pour chacun, de raconter sa “vie antérieure”. C’était,avait-il dit, une manière de raconter son humeur. Soit une vie atroce dont on s’était libéré par une vie présente extraordinaire. Soit une vie de rêve comparée à celle que le narrateur subit.
La soirée s’annonçait bien, tous souriaient, allez savoir pourquoi. De fait la soirée se déroulait bien. L’un des invités proposa un jeu. Il s’agissait, pour chacun, de raconter sa “vie antérieure”. C’était,avait-il dit, une manière de raconter son humeur. Soit une vie atroce dont on s’était libéré par une vie présente extraordinaire. Soit une vie de rêve comparée à celle que le narrateur subit.




