J’ai hésité avant de la coller ici, l’histoire de Louis. C’est une histoire vraie.
J’ai rencontré Louis Beauregard (je change le nom) à la faculté. Il travaillait sur un sujet assez curieux, pour l’époque du moins : la relation entre les comportements alimentaires et les modes de pensées. En bref, si je me souviens bien, Louis considérait que le fait d’ingurgiter depuis la prime enfance des hamburgers ou du riz biriani déterminait le mode de perception du monde, et partant, le type d’action culturelle sur son environnement.
Quand certains lui rétorquaient que la proposition inverse était peut-être plus pertinente, que le comportement alimentaire n’était qu’un succédané de la culture d’un peuple, un fait sans vecteur causal, il prenait un air très sérieux, regardaient les contradicteurs fixement avant de lâcher d’un air faussement contrit :
– Vous êtes un petit con.
Là, ça dépendait des interlocuteurs. La majorité, ne pouvant imaginer la vérité de l’insulte, le prenait pour un fou et tournait le dos pour s’enfuir.
D’autres, plus rares, riaient et discutaient. Enfin, les derniers s’emportaient et devenaient même violents.
Je l’ai justement connu lors de l’emportement, peut-être légitime, d’un malheureux questionneur.
Nous étions, tous, dans le couloir à attendre la venue du Professeur Didier, titulaire de la Chaire d’épistémologie, lorsque j’ai entendu des éclats de voix assez violents. C’était Louis qui se faisait empoigner le collet par un étudiant, assez grand, certainement basketteur, et qui exigeait des excuses après avoir entendu la petite phrase assassine, en réponse à sa question, pourtant posée calmement.
Louis le regardait sans broncher, ce qui provoquait un redoublement des cris.
Je m’approchai, et malgré mon ignorance de l’origine de la dispute, je fis remarquer au géant que le lieu ne pouvait se prêter à un tel comportement, indigne de la sérénité qui devait régner dans cet espace où les plus grands esprits, depuis des siècles, opéraient.
Le violent me traita d’imbécile et me demanda de m’occuper de mes affaires, en ajoutant je ne sais quelle insulte intolérable. Et alors que je ne connaissais pas encore l’ignoble répartie régulière de Louis, je répondis au malotru :
– Vous êtes un petit con.
Il en a été stupéfait puisqu’aussi bien il lâché Louis qui se tordait de rire, m’a regardé, a hésité pour l’uppercut, avant, je ne sais pourquoi, de partir en courant vers les toilettes.
Louis est, évidemment, devenu un ami, du moins un proche de Faculté.
Il a, très vite, abandonné son sujet pour s’intéresser au fait religieux et plus précisément à ce qu’il nommait lui-même “l’ultime preuve négative”.
Il s’agissait de démontrer qu’eu égard à la conservation des documents historiques et des récits de l’époque, à la connaissance parfaite des évènements majeurs dans les siècles, à leur restitution par les chroniqueurs, il était impossible de démontrer l’existence de Jésus qui, en réalité constituait une invention magistrale, l’homme ou le Dieu, comme l’on voudra n’ayant jamais mis les pieds sur terre. Nul document sérieux
n’en faisait état.
Son travail intéressait nos professeurs puisqu’en effet il permettait de répertorier le matériau historique de l’ère préchrétienne, d’en disséquer le contenu. Et même si le but de telles investigations était curieux, la démarche pouvait faire “avancer la recherche”. C’est ce que nous disait le Professeur Chesneau, celui dont l’on sait qu’il n’a pas supporté l’apologie par Michel Foucault du régime islamiste iranien et qui s’est suicidé en plein cours, en avalant du cyanure.
Les travaux de Louis ne m’intéressaient guère, mais j’avais toujours plaisir à le rencontrer, pour discuter de tout et de rien.
Puis, un jour d’été, Louis m’appela et demanda à me voir sur le champ.
Je m’en souviens parfaitement. Il me dit :
– Tu te souviens que tu es juif ?
Et avant que je ne m’emporte il m’annonça la nouvelle :
– Je me convertis au judaïsme.
J’aurais dû immédiatement, lui poser la question du pourquoi. Mais, curieusement, je n’ai pu dire qu’une seule phrase :
– Vas-tu porter la kippa et le petit talith ?
Il m’a souvent dit par la suite combien cette réaction l’avait étonné. Il. s’attendait à mille questions, à la stupeur, à la joie, bref à un sentiment.
Je crois que ma réaction l’a un peu peiné, mais je n’y pouvais rien.
Il n’a pas porté la kippa et le petit talith et n’a pas laissé pousser sa barbe. mais il est devenu, je l’assure, l’un des plus éminents spécialistes du judaïsme que certains n’ont pas hésité à comparer au mystérieux Monsieur Chouchani, maître de tous les grands, y compris de Lévinas ou de Wiesel.
On affirmait de Louis qu’il n’existait pas un texte biblique, de la kabbale,
du Zohar, de la Michna qu’il ne pouvait citer de mémoire et pas un seul des milliers de commentaires talmudiques qu’il ne pouvait, lui-même critiquer. Je pense que c’était, peut-être un peu exagéré.
Il avait, par ailleurs refusé de devenir rabbin, malgré les offres mirobolantes des plus grandes métropoles. Il n’avait qu’un seul but, répondait-il aux nombreux journalistes qui venaient l’interroger sur ses travaux : démontrer la concordance parfaite entre modernité et judaïsme qui n’existait que nous donner à voir la « contemporanéité ».
Louis n’écrivait que très rarement, prétendant que le caractère sacré des
mots était exclusif du petit exposé d’une pensée ou d’un commentaire. Si l’on écrivait, c’était pour dire une vérité, laquelle ne pouvait s’encombrer
d’à-peu-près et d’imperfections sémantiques.
Un texte devait donc être court et essentiel, rare ou, mieux encore, brûlé comme le soutenait le rabbin Nahman de Braslav, pour laisser les mots s’envoler dans le vent du ciel et trouver leur destination authentique.
Seul le roman, la littérature, si l’on veut, pouvait se laisser aller, ne pas rechercher la perfection puisque par essence même, elle la fuyait “trouvant dans les mensonges la vérité de son existence”.
Je me souviens l’avoir appelé lorsque j’ai lu ces mots dans une revue hebdomadaire, dans un entretien qu’il accordait au rédacteur en chef, en réponse à une question sur la relation entre littérature et religion.
Je connaissais bien Louis et sans mettre en doute ses nouvelles convictions religieuses, je savais trop qu’il s’agissait de mots de faiseur, de charlatan de pure race, pour épater, dans le sillage de Kundera, les lecteurs du Dimanche.
On ne se refait pas, même dans l’érudition.
Lorsque je l’ai appelé, après la lecture de ces mots pompeux, il y a très longtemps, pour le traiter gentiment d’escroc, il m’a simplement répondu :
– je préfère faire le pitre plutôt que de m’assoupir, comme toi, dans un spinozisme inutile, primaire et résigné.
J’avoue avoir été un peu vexé, mais nous nous sommes rencontrés très souvent. Cependant, j’avais exigé l’exclusion radicale de toute discussion théorique entre nous, peut-être par crainte de ne pas suivre, sauf celles, futiles, sur la cuisine, et l’art contemporain qu’il vomissait.
Pas un seul mot de philosophie, de politique et encore moins de religion. Le pari a été tenu pendant de longues années.
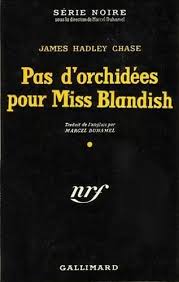 Le temps est donc, comme souvent lorsque le dernier bouquin vous tombe des mains, à la relecture. Il faut toujours relire. Ca nous fait voyager dans une vie. La sienne évidemment. La bibliothèque dans sa liseuse ou sa tablette est, pour ce faire, prodigieusement au point.
Le temps est donc, comme souvent lorsque le dernier bouquin vous tombe des mains, à la relecture. Il faut toujours relire. Ca nous fait voyager dans une vie. La sienne évidemment. La bibliothèque dans sa liseuse ou sa tablette est, pour ce faire, prodigieusement au point.






