Devant une bière, une amie a évoqué quelques “incursions ” fructueuses dans le judaïsme, fabricant du concept autant que de la joie.
Le mot employé m’a interpellé. J’ai cherché et trouvé.
Un ami proche m’avait, il y longtemps, envoyé le texte qu’il avait vite et fébrilement écrit à la mort du père.
Je l’ai retrouvé et le colle ici (avec son autorisation acquise à l’instant, sans cependant mentionner son nom)
Bonne lecture !
“L2e 24 Avril 2009
Incursion dans les « pâtures du vent »
1 – Chaque homme est comptable de ce qu’il a reçu et qu’il doit transmettre. Mon père a observé la règle.
Je m’interroge sur ce que j’ai pu transmettre. En réalité, ce questionnement est récent puisqu’en effet, une obstination à nier l’existence même d’un sujet libre et conscient, à affirmer le déterminisme des trajectoires, m’en a écarté.
Cette conviction définitive m’a éloigné de la parole et du dialogue, auxquels j’ai substitué le travail du concept et de l’outil théorique. J’ai détesté Levinas et l’appropriation idyllique de « l’autre ». J’ai haï les psychologues, psychanalystes, les poètes de l’âme, les intimistes de service. J’ai encensé la pudeur, ri à la lecture du récit du « moi », raillé la confidentialité, écarté l’intériorité.
La contiguïté faisant défaut, je ne pouvais donc m’insérer ou m’immiscer dans les destins. Mon monde était donc impeuplé.
2 – Et la mort est arrivée, la première, couchant le corps du père à même le sol. Ma chemise a été lacérée par le rabbin, j’ai récité plusieurs fois par jour le kaddish des orphelins. Je me suis déchaussé devant des inconnus priant sur notre tristesse. J’ai dormi dans la maison du mort.
Le sujet m’a rattrapé, la question m’a soulevé. A trop rechercher, obsessionnellement, la querelle théorique, je m’étais figé dans une froidure inféconde.
4- Mon retour au judaïsme est, évidemment, convenu et je ne peux blâmer l’entourage qui sourit devant ma nouvelle obsession.
Je leur dis que je ne suis pas figé, béat, devant l’impénétrable ou cadenassé dans la piété. Je ne m’agenouille pas et n’implore rien. J’honore le père et, par le texte, concentre la révérence.
La mort du père est le prétexte d’un déplacement, à l’évidence annoncé.
5 – J’ai donc, déterrant la parole, lu tout ce qu’il était possible de lire dans ce laps de temps, vite, très vite. Il me fallait rapidement écrire.
J’ai retiré de cette brasse nerveuse énormément de plaisirs. Même si c’était à la hâte, sans rigueur ni approfondissement, même si l’identification d’une obsession m’a gâché, quelquefois, la découverte.
Cette pulsion et ses succédanés (l’isolement dans la lecture et l’embrasement littéraire) sont guettés, reprochés par mes proches qui doivent craindre je ne sais quelle catastrophe.
6 – Donc un plaisir. Plaisir de retrouvailles avec les principes fondateurs, plaisir de la mise à l’écart du concept qui me permet de briller en fabriquant ma différence et ma reconnaissance.
Je connais mes travers. Je sais qu’il me faut toujours, dans ma relation aux autres, souligner l’intensité, la fulgurance de l’idée exposée, la difficulté du concept dont je suis le maître, en les sommant de m’admirer. Je le sais. L’incursion dans cette contrée inconnue m’aura sûrement appris une modestie.
4 – J’ai donc tenté de faire le vide et remiser ma prétendue connaissance.
Le texte d’un rabbin, parait-il fort connu, m’a conforté dans cet effacement radical.
Nahman de Braslav, commentant la nécessité radicale de l’innovation (conceptuelle) tient ce propos :
« les maîtres sont dans l’incapacité d’innover car ils sont trop savants…son savoir (celui du maître) gigantesque le trouble et l’enferme ; il commence à formuler de nombreux préliminaires et à faire le résumé de la synthèse de ses connaissances sur le sujet et, de ce fait ses propres paroles s’embrouillent et il ne peut produire aucune parole nouvelle intéressante….lorsque quelqu’un désire innover des sens nouveaux, il doit restreindre son savoir (faire le « tsimtsoum », la « contraction » de son esprit) , faire le vide….il doit faire comme quelqu’un qui ne sait pas et, seulement alors, il peut innover des sens nouveaux en ordre …»
Ce texte simple m’a paru lumineux. Il s’adresse bien sûr aux maîtres et ne saurait me concerner.
Mais, encore une fois, la crainte de la plate redondance, d’une redite mal exprimée de ce qui a été mille fois répété, m’a toujours empêché de, simplement, recevoir une pensée qui ne soit pas estampillée.
Comme je le crois toujours, mais peut-être un peu moins, l’approche dite « existentielle » de la connaissance m’a toujours paru suspecte. L’invention est rare et seul le style diffère. C’est ce que j’affirmais.
J’ai, d’ailleurs, présomptueux, prisonnier de ce qui me reste d’orgueil, imaginé, dans un premier temps, que mon texte synthétique sur le judaïsme allait confronter magistralement concept philosophique et religion, analyse du texte et inscription dans l’histoire de la pensée.
Je convoquai dans mon esprit tous les philosophes du monde, dérangeant l’ordre de ma bibliothèque, fabriquant les plans les plus audacieux. J’allai produire ce que tous attendaient : une synthèse du tout, de la pensée des hommes.
J’ai vite compris l’inconséquence de cette prétention, de cette arrogance. Et ce pour deux motifs :
Tout d’abord, le premier, rédhibitoire : ma connaissance, ma culture philosophique, partielle et brouillonne ne le permettaient pas.
Ensuite, la « contraction » du judaïsme dans l’analyse me faisait perdre le fil, « m’embrouillait » comme le rappelle le rabbin de Braslav.
J’ai donc, dans cette approche, cette « caresse des textes », retenu l’impératif catégorique de la vacuité, détruit les préliminaires épistémologiques, les références automatisées, démoli le socle des convictions théoriques, organisées autour d’un matérialisme confus.
Il est vrai que ce rabbin de Braslav, si l’on cherche, comme toujours, le lieu commun, ne dit rien d’autre que le devoir du doute méthodique, mille fois rabâché.
Mais dit par un rabbin, avant de plonger dans le judaïsme, cela est mieux dit.
5- Pour finir, je voudrais ajouter quelques mots sur le « style », le mien. Je fais preuve, à nouveau, d’immodestie outrecuidante en abordant ce thème. Comme si je prétendais à une signature, un style. Je jure qu’il n’en est rien.
Cependant, dans mes tentatives passées de coucher des idées, d’écrire un roman, il semble que l’ornement, l’enjolivure, l’emportaient sur la clarté. On m’a toujours reproché l’emphase et l’inutile flamboyance.
Je me suis essayé, dans cette introduction, à la concision et le mot simple, effaçant mille fioritures. En me relisant, je regrette l’absence, ici et là, d’une virgule, d’une parenthèse, d’un embellissement.
J’ai pu lire que la Michna (recueil de la législation civile et religieuse qui forme avec la Guemara qui en est le commentaire, le Talmud) se présente dans un style simple et concis, mais souvent « obscur à force de concision ». Je ne commente pas, pour ne pas tomber dans mon travers.
5 -J’écris, assez serein, en ayant à l’esprit les fêtes dénommées « Hakhnassat Sefer Torah » à l’occasion desquelles une famille offre la Torah à ses convives qui sont invités à écrire les dernières phrases, les dernières lettres du Livre. Pour rappeler l’obligation pour chaque être humain d’écrire un livre. Rien de plus sublime que cet impératif.
J’ai donc lu et livre ici, imparfaitement, sans relecture, ce que j’ai pu retenir.
Je prie, très sincèrement, ceux qui me lisent de m’accorder leurs excuses devant cette vanité. Je les supplie de croire en cette sincérité.
Judaïsme.
« S’il y a un monde où, cherchant la vérité et les règles de vie, ce que l’on rencontre, ce n’est pas le monde, c’est un Livre, c’est bien le judaïsme, là où s’affirme, au commencement de tout, la puissance de la parole et de l’exégèse, où tout part d’un texte et tout y revient, livre unique, dans lequel s’enroule une suite prodigieuse de livres, bibliothèque non seulement universelle, mais qui tient lieu de l’univers et plus vaste, plus énigmatique que lui » Maurice Blanchot.
1 – Je ramasse donc ce que j’ai retenu de cette courte incursion dans les textes qui m’a permis d’approcher la nature spécifique du judaïsme.
Comme tout novice, je réfute la critique attendue. Celle émise par ceux qui, immédiatement, s’empresseront d’affirmer qu’il ne s’agit là que de notions ou principes qui fondent tous les monothéismes, nonobstant le parement, la chamarrure dans l’exposé.
Je ne l’accepte pas. D’abord par parti pris, ensuite parce qu’elle n’est pas pertinente.
Si j’échoue dans cette tentative d’isolement d’une particularité, c’est, certainement, du fait de mon incompétence à la traduire, de mon ignorance des mots qui la révèlent.
Je suis convaincu de la justesse de la proposition quand j’affirme la singularité du judaïsme et, partant, paradoxalement, son universalisme. Une telle affirmation à l’heure du relativisme ambiant peut paraître ancrée dans la terreur théorique.
Mais, tout ne se vaut pas. Et il nous faudra encore quelques siècles pour revenir à la limpidité jouissive des universaux, inventés par une poignée d’irréductibles. Rappelés par Dieu, pourrait-on dire.
En réalité, cette sensation du « déjà-lu » n’est que la confortation de l’universalisme et des valeurs séculaires que, curieusement, l’on n’attribue pas au judaïsme, gommant la caractère fondateur de sa doctrine, sauf pour le noyer dans le « judéo-chrétien », expression désormais remplacée par « l’Occident ».
Je reviendrai, plus loin, sur la catastrophe qu’a représentée, du point de vue de l’intelligence, l’idolâtrie chrétienne.
Je revendiquerai donc, malgré toutes les réprobations, l’originalité, au sens premier du terme, du judaïsme qui se gausse d’agenouillements béats, de vitraux magnifiques, de divin incarné dans le sang, de tragique théâtral et qui préfère la pratique de l’Ethique, dans la recherche de la Lettre. Celle de la Torah.
2 – La violence de l’annonce de mon parti pris m’étonne moi-même.
Mais j’ai, enfin, décidé de remiser « la neutralité objective » dans les placards de la politesse. Je sors donc des oripeaux du « gentil » juif.
Juif gentil et acceptable par son dénigrement de la religion et d’abord la sienne et qui fabrique la bienveillance de l’accueil parmi les tenants de la liberté, des Lumières, de la Raison . Flagrant « recul » théorique du juif libéral que l’on constitue athée et donc fréquentable. Recul de soi et éloignement des siens, pour intégrer le clan des relativistes bon teint ou des antisémites culturels.
A dire vrai, je ne risque rien, dans l’élaboration de ce texte, dans l’affirmation du judaïsme (même si, encore frileux et lâche, je n’écris pas « mon judaïsme »). Je ne serai même pas exclu du monde des « Gentils ». Ils adorent le juif critique et provocateur, et s’extasient même, en le ramenant à lui, sur cette particularité séculaire.
Le format de leur « pensée » est donc parfaitement compatible avec mes affirmations rageuses et conforteront la conviction ou la certitude de leur intelligence. Elle trouvera son compte dans cette contigüité merveilleuse et féconde avec un juif qui « pense », s’interroge, revient et anime la discussion arrosée et tardive. Exotisme délicieux, sourire entendu.
3 – Il est temps, désormais, de s’atteler à la tâche de la répétition et prie mon lecteur, à nouveau, d’excuser mon culot.
Dans ce qui suit, l’on ne repérera aucune construction, s’agissant de mots, noms et principes jetés pêle-mêle, même si j’ai tenté d’éviter la débandade. Il ne s’agit ni d’un dictionnaire, les entrées s’organisant au gré de je ne sais quoi, ni, bien sûr, d’un exposé didactique. Simplement d’une incursion légère, comme je dis dans le titre.
Ce titre est tiré du Qotelet, l’Ecclésiaste si on préfère. (« J’ai donc observé toutes les œuvres qui s’accomplissent sous le soleil: Eh bien! Tout est vanité et pâture de vent »).
Je livre donc.
YHWH. On ne peut que commencer par l’imprononçable (premier interdit) du nom de Dieu, tétragramme constituant une « flexion verbale artificielle de la racine trilitère היה, HYH(« être » ou « devenir ») et dont certains affirment qu’il pourrait s’énoncer ainsi : « Il se prépare (à être) en étant », ou « en étant Il devient ». Le rejet de la forme accomplie hâyâh pourrait signifier : « Il n’a jamais fini d’être. » mais les philologues modernes le traduisent par « Je suis celui qui suis » (Ehyeh acher ehyeh », ou par la locution l’Éternel.
Fabuleuse abstraction ravalée dans la personnification, et donc l’idolâtrie, par les traducteurs chrétiens inventant « Jéhovah » ou Yahvé pour donner au peuple, dans une traduction infantile, de quoi s’y reconnaitre. Nominalisme réducteur qui nous ramène au visible et au fini, alors que l’imprononçable est déjà théorie du Tout. Le Nom est exclusif de l’infini, impensable.
Rien de plus faux, rien de plus traître que cette prononciation, cette traduction. Car ce tétragramme, imprononçable, ineffable, est l’idée la plus féconde, la plus géniale du judaïsme qui convoque, par une sorte de jeu mouvementé, l’intelligence des hommes et la met au travail. Ce travail de « charge » de l’imprononçable, est cependant concret. Il n’est pas discours conceptuel.
Dieu, dans la religion juive n’est pas le fruit de spéculations philosophiques ou d’intuitions mystiques, de la mise en œuvre d’une « béatitude », de la croyance en un Dieu statutaire ou de son fils qui sonne comme une flagellation de l’esprit vif des hommes.
Ce « silence » de l’imprononçable, donné comme une sorte de réceptacle vide dans laquelle la pensée va se ramasser est l’essentiel du judaïsme.
L’imprononçable est, en effet, exclusif de l’idéologie ou, encore une fois, de l’idolâtrie, le nom appelant l’image et la représentation.
Incroyable jeu du remplissage abstrait et non imagée de l’espace ouvert, non définitif, « attrape-esprit », « attrape-intellect » que nous permet cette invention du judaïsme.
Le judaïsme qui ne permet pas la vulgaire traduction chrétienne du tétragramme a mille fois raison. Dieu, en ce qu’il ne se prononce pas est « impiégeable » (François Angelier).
Il est dommage qu’il n’existe aucun concept imprononçable, l’esprit aurait, déjà fait un bond immense. Mais les hommes ont besoin de béquilles, même si elles se substituent au vrai, c’est-à-dire à la recherche. Il faudra faire avec le nominalisme. Einstein lui-même le rappellera en énonçant sa « religion cosmique ».
Il faut rappeler, cependant que, dans le judaïsme, Dieu a d’autres noms : Elohim, Adonaï. Autres noms qui ouvrent d’autres portes pour la convocation de l’intelligence. On est invité à les ouvrir. Mais jamais devant l’image d’un barbu.
Le commandement, adjacent à l’imprononçabilité, selon lequel « tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain » est, aussi, un des traits du génie du Judaïsme.
Liberté de l’interprétation mais absence de l’automatisme. Incroyable religion du concret (le judaïsme est une pratique, plus qu’une croyance) qui le fait cependant voyager dans l’intelligence, pour atteindre l’enveloppe diaphane qu’il faut remplir…
On pourrait dire aussi que le juif ne fait rien en vain. Sa vie est une recherche. Il faut être, affirme t-il, toujours vigilant dans le recherche de « qui est Dieu » et ne pas se contenter du texte, serait-celui de la Torah du Talmud, ou d’une conviction.
Le philosophe (Alain) nous rappelle «qu’une idée même vraie devient fausse à partir du moment ou l’on s’en contente ».
On en arrive au comble lorsque rejetant l’idolâtrie à l’endroit d’un « gouvernement d’en haut » Marc-Alain Ouaknin « rabbin et philosophe » ose clamer, vilipendé, non sans motifs, par l’orthodoxie, et maniant la provocation, le jeu de mots et, sûrement, la phrase vaine et vide, qu’il est un « un rabbin athée, Dieu merci ! “, en martelant qu’il « revendique ” l’athéisme métaphysique ” dont parle le philosophe Lévinas, dans “Totalité et infini” (2) : une forme de relation à Dieu qui n’est ni la voie mystique dans laquelle l’homme ” monte ” tellement vers Dieu qu’il s’annule dans le ” Grand tout “, ni l’idolâtrie qui fait tellement ” descendre ” Dieu dans le monde des hommes que celui-ci devient une idole. Je propose une relation qui maintient une distance entre Dieu et l’Homme. Le texte, et l’interprétation des Textes, est justement le tiers grâce auquel on évite collusion et confusion ».
En ajoutant que :
« Le mot “foi” en hébreu renvoie essentiellement à la notion de fidélité. Ni religieux, ni laïc, je me situe dans la lignée de ceux pour qui la spiritualité est une recherche, un questionnement et une fidélité à ce qui leur a été transmis. Une référence pour moi reste Albert Cohen qui écrivait, à plus de 80 ans, dans ses “Carnets 1978” (3) : “Dès que je crois, je trébuche et je ne crois plus. Dès que je ne crois plus, je me relève et je veux croire.”
Il expliquera, ce téméraire, plus loin, que vivre sa spiritualité au quotidien, pour un juif, consiste simplement à faire preuve de « bonté » au sens de « petits gestes », ceux qui constituent l’amour, au sens juif. Bien loin de la vision chrétienne de la joue tendue que l’on lacère sous les couteaux de Torquemada…
On était parti de l’imprononçable YHWH, pour arriver aux « petits gestes ».
Le judaïsme nous fait monter et descendre des collines spirituelles pleines d’embûches, de bruit sans fureur.
En écrivant ces derniers mots, je pense, bien sûr, à Shakespeare et sa définition de la vie, du monde (« c’est un récit (ou une fable) conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien »). On est loin de là.
Dans le judaïsme, me semble t-il (mais je m’aventure peut-être dans mon ignorance), Dieu, évidemment pas idiot, ne « conte » pas. Il laisse les hommes «le » conter, par ce qu’il leur a donné (Torah). C’est, comme on le verra plus loin leur seule mission, leur responsabilité : créer Dieu qui les a créés, justement pour le conter et, dans le récit du Divin, s’attaquer au bruit inutile et à la fureur vaine. Homme, auto-outil de Dieu. Divine responsabilité des hommes. Ni divine comédie, ni destin tragique.
Je reviens au nom imprononçable. En réalité, il est dit dans des franges (tisitt), celles du Talit (châle de prière). Le Tétragramme YHVH correspond, dans sa valeur numérique (voir guématria et assignation des mots à leur valeur, chaque lettre hébraïque correspondant à un nombre) au chiffre 26. Le nombre des nœuds, tours, fils, dans leur organisation pour confectionner les franges aux 4 coins du Talit est bien de 26. Le nom de Dieu est à la frange.
Livre. Evidemment. Beaucoup de textes dans le judaïsme affirment l’existence de la Torah (le pentateuque) au ciel, avant même la création du monde. Comme dans cet extrait des « Proverbes » : « L’Eternel m’a créé (Torah ou sagesse), principe de sa voie, antérieurement à ses œuvres, depuis toujours ; dès l’éternité j’ai été formée, dès le début, antérieurement à la terre ». Entité métaphysique préexistante qui sert de « modèle spirituel à l’Univers », ai-je lu.
Et les juifs en sont les dépositaires, distingués parmi d’autres pour recevoir le « schéma ».
On peut donc admettre les poncifs qui pullulent (« Peuple du Livre …). Le lieu commun me semble vrai et faux.
1 – Vrai car le judaïsme s’incarne, se révèle, se constitue dans ce Livre qui lui a été donné sur le Mont Sinaï.
Le juif ne se pose d’ailleurs pas la question de « Qui est Dieu ?» laquelle est inutile puisqu’ il « est ce qu’il est », réceptacle imprononçable que j’ai déjà évoqué.
Il ne cherche pas la nature de Dieu. Il ne s’interroge, en réalité, que sur la manière avec laquelle il s’est révélé, comment l’infini (le divin) a choisi de rencontrer « le fini » (l’homme). Sa réponse est claire : dans un texte qui se confond avec celui (Dieu) qui le lui a donné.
Le premier avènement de Dieu, c’est, clairement, concrètement sa révélation. Elle se constitue, se fabrique (au sens de la création) dans la Torah. Il est donc la Torah elle-même. Il n’est d’ailleurs pas inutile de préciser que la mystique juive dit : « Le Saint Béni soit-il et sa torah ne font qu’un ». Et Levinas le répète : « Dieu, c’est la Torah et la Torah, c’est Dieu ».Dieu serait ainsi un Livre. J’aime cette idée géniale selon laquelle Dieu est dans des lettres.
Une certaine mystique juive va même décrire la naissance du Monde par la lumière pénétrant l’espace vide sous la forme des 22 lettres de l’alphabet hébraïque, chevaux de feu !!
Bien sûr, le niveau d’appréhension de Dieu est, par cette réponse, métaphorique ou poétique, comme on voudra.
Nul juif, même si à l’office il embrasse les rouleaux du Pentateuque, n’imagine, une seconde, trouver Dieu sous le parchemin. Mais la Torah est sacrée puisqu’elle renferme un don de Dieu et donc une partie (qui n’est pas son fils) de « lui ». La métaphore est pleine d’enseignements.
On voit ici que le raccourci entre Dieu et le texte évite, peut-être rapidement, la question de la consistance de Dieu, en entrainant le juif dans « ce qui est » : des lettres gravées.
On peut adhérer au lieu commun en affirmant, avec tous, que le peuple juif est bien le peuple du Livre, son Dieu étant Lettre.
On comprendra mieux cette proposition lorsque l’on abordera la passion des juifs pour la « guematria » (géométrie et valeur numérique des mots qui renvoient à l’essence qui se trouve dans les lettres).
L’identification de Dieu, la recherche de sa nature lui semble étrangère car elle le placerait dans une métaphysique transcendantale construite autour de la piété absolue et du mystère de Dieu, comme le fait le chrétien. Ce dernier s’est tellement interrogé sur le fait de savoir « Qui est Dieu ?» qu’il en a créé plusieurs pour répondre à l’angoisse terrestre que l’idolâtrie guérit : fils de Dieu et vierge Marie.
On peut constater que le christianisme a, définitivement, du moins dans son discours quotidien, écarté le nom de Dieu, au profit de Jésus. J’ai toujours été frappé par cette absence sémantique qui veut dire beaucoup. Le nom de Dieu, sans son fils, n’apparait qu’épisodiquement, notamment dans la lecture du Pater Noster lequel est, faut-il le rappeler, une prière juive.
La chrétienté, pour s’affirmer dans la concurrence a donc renié, en le jetant dans la chronologie, le génie du judaïsme et son « ancien » testament en interdisant à ses adeptes de continuer l’aventure de l’ineffable.
Tout s’est passé comme si l’infini, invention nodale des hommes ou réalité immatérielle, comme l’on voudra, avait été gommé, lapidé. Sur la croix. Jésus, corps fini, corps certain l’a effacé. Dommage pour les hommes lesquels, responsables de l’Univers et devant eux-mêmes, méritaient mieux que ce galimatias de l’idolâtrie.
Je ne peux m’empêcher, s’agissant d’un texte « personnel », de dire que je ne cesse de pester lorsque le Dimanche matin, j’écoute les inepties proférées sur un ton plaintif et pleureur, à l’œuvre dans les émissions religieuses chrétiennes. Je ne veux insister, de peur de tomber dans le jugement et l’ironie faciles. Mais je plains, sincèrement, mes semblables catholiques et protestants.
2 – Mais, comme je le disais plus haut, ce n’est pas tout à fait vrai : le juif n’est pas le peuple du Livre, entendu comme immuable. On pourrait même affirmer qu’il est celui qui doit s’en détacher. Paradoxe que je découvre, même s’il est un peu forcé sous la plume de penseurs qui manient bien l’emphase.
Je cite le rabbin Ouaknin :
« Les lettres sont des étincelles de sainteté de l’Être divin, qui s’est éclaté, déployé, finitisé dans la Torah, qui est le Tsimtsoum, la contraction de l’infini divin dans la finitude des lettres. Donc le rapport à la Torah est un rapport à la Kénose, c’est-à-dire à l’acceptation par l’infini divin d’être assez humble pour s’enfermer dans la finitude des lettres de l’alphabet. D’où la responsabilité des hommes, par rapport à Dieu, de lui redonner son statut d’infini en interprétant le texte de la Torah, non pas en le lisant platement, ce qui maintiendrait le divin prisonnier de la finitude, mais en interprétant le texte sans relâche, de manière infinie, de façon à lui rendre son statut d’infini. J’interprète, donc Dieu est. Car Dieu retrouve alors le souffle d’infini qui était prisonnier dans les lettres de l’alphabet. Et Levinas le dit clairement, dans Nouvelles Lectures talmudiques (en cela il est kabbaliste lituanien, comme il l’affirme, mais aussi kabbaliste hassidique, sans le savoir) : “Dans chaque mot et chaque lettre, il y a un oiseau aux ailes repliées, qui attend le souffle du lecteur. Et lorsque le lecteur interprète, l’oiseau déploie ses ailes, et il ne faut pas oublier de sauter sur son dos, pour monter vers l’infini.” Que voudriez-vous de plus mystique que cette image ?! »
Le peuple juif s’il n’était que le peuple d’un Livre, ne ferait que lire ce qu’il a reçu en transformant le texte en un objet fini devant lequel l’on ne peut que se prosterner. On nomme cette posture idolâtrie.
Or, et c’est la richesse incroyable du judaïsme, le Livre, à l’inverse de ceux qui le proclament, y compris parmi les juifs pratiquants, est tout sauf un corps de lettres ou de mots finis. Bien au contraire a-t-on lu plus haut : si Dieu s’est fait livre en se « contractant » (Tsimtsoum), on doit le « libérer » pour qu’il revienne dans l’infini.
D’où l’obligation de ne pas se prosterner devant le Livre, l’interpréter, pour lui donner sa richesse, le rendre à Dieu pour l’aider à retrouver l’infini. Le peuple, juif ne fait que ça depuis des siècles. Le Talmud est, j’ose l’écrire, une démolition magnifique du Texte, jamais figé comme l’idole au milieu d’un peuple qui erre dans le désert.
Le peuple juif est donc le peuple d’un Livre qu’il effrite pour le rendre léger. Et cette légèreté construite pourra, seule, lui permettre de s’envoler vers sa cause : Dieu, cause de lui-même.
Les lignes qui précèdent, je l’affirme, même si je n’ai pu m’empêcher de tomber dans le travers du lyrisme que je découvre dans la poétique juive correspondent, très exactement à ce que j’ai pu comprendre.
Il faudra, mais c’est un tout autre sujet, expliquer la compatibilité entre cette « dé-sidolâtrie » du Livre et l’injonction de son respect, à la lettre, pourrait-on dire, qui domine dans le judaïsme majoritaire.
Il est vrai, et je leur donne raison, que le judaïsme ne peut être simplement métaphorique. Le mysticisme et ses images de rêve ne peuvent fonder une religion, surtout quand elle se veut pratique et concrète. C’est le piège dans lequel est tombé le christianisme intellectuel. Ce qui n’a pas empêché cette chrétienté, direz-vous, d’être très pratique dans ses assassinats, ses pogroms. En devenant, contre toute attente, le peuple du Livre qu’on brule au nom d’un rabbin exécuté.
J’aime cette idée que tout est dans la Torah. J’aime cette foi dans la lettre, dans les lettres. J’aime cette idée qu’à l’inverse des autres religions l’infini (Dieu) ne s’est pas incarné dans l’homme mais dans un texte : la Torah qui est Dieu.
– Distinction, élection, mission. Pour amortir le choc, certains opèrent une distinction entre « peuple élu » et peuple « distingué », ce dernier adjectif semblant moins provocateur. Un peuple a donc été distingué entre tous, pour accomplir une mission (celle, on y reviendra, de justice sociale, Tsedaka, fondement réparateur du Monde).
L’affirmation de ce statut singulier a fait couler beaucoup d’encre et souvent beaucoup de sang. Quelques mots sur cette alliance :
D’abord, j’aime l’idée, présentée par Maimonide selon laquelle il ne s’agirait pas d’une élection conférant des droits ou des privilèges, mais des devoirs. Certains prétendent que sans l’accomplissement desdits devoirs, l’alliance serait rompue. D’où le rappel de la stricte observance des règles édictées. D’autres y voient plutôt un aspect messianique : le peuple juif a le devoir d’enseigner au monde la Justice tirée du modèle de la Torah.
J’aime, évidemment cette seconde proposition, même si elle conforte l’antisémitisme. Non seulement élu mais, au surplus donneur de leçons de justice. Le juif se prend pour Dieu, il faut l’anéantir…
Et pourtant, c’est bien cette conception transformée de l’élection qui domine dans le judaïsme moderne, et notamment dans celui qui est considéré comme son chef de file. Je veux parler de Moïse Mendelssohn qui a fait entrer les Lumières, la Raison dans le judaïsme.
A la question « Pourquoi rester juif ? », il répondait qu’ils avaient été « singularisés » dans l’histoire par la révélation sur le Mont Sinaï et que leur devoir était de demeurer les détenteurs de cette révélation ; qu’ils leur incombaient de d’accomplir leur mission de transmission universelle du message divin.
L’on se doit néanmoins d’ajouter que l’orthodoxie exige que soit proclamé, notamment dans certaines prières de fête (« amidah ») le « tu nous a choisi ».
Si je suis revenu sur cette notion d’élection, c’est en réalité pour dire ce qui m’a toujours frappé : le peuple juif ne l’a jamais transformé en ethnocentrisme, ne l’a jamais utilisé pour s’ériger dans la distinction absolue. Bien au contraire, quand on rappelle ce qu’il a pu subir des « goys », mot que je ne connaissais pas avant ma venue en France, et qui se range selon moi plus dans la taxinomie, la classification sans idéologie que dans le rejet ou le mépris des « non-élus ». La fierté d’être juif n’a jamais dépassé le clan ou le village. Il a fallu attendre le mot de Gaulle pour imaginer son caractère « dominateur » (peuple fier de lui et dominateur »). Irruption d’un mot lorsque le juif ne se plie pas. A la chrétienté semble t-il.
Juif athée. La notion de juif athée, l’attachement à un peuple, à une histoire, sans foi et qui témoigne, plus qu’ailleurs puisque sans nationalisme (l’attachement de la diaspora à Israël n’en est pas un) de la vivacité de la notion de communauté entre des hommes, d’abord celle la plus proche, mais ensuite (c’est même la mission conférée à Abraham) celle du monde qu’il faut « réparer » me fascine.
On peut ajouter, mais le débat est vain et fatigant, que la question de savoir qui est juif me concerne, évidemment, mes enfants n’étant pas de mère juive. Je ne l’alimente pas.
Mais il faut savoir qu’un juif athée me semble plus croyant que son homologue chrétien puisqu’il intègre (voir YHWH) la pensée immédiate de la non-idolâtrie.
Cette perception séculaire de l’accueil de l’imprononçable et du vide abstrait, dans lequel il peut mettre le concentré d’une pensée, même en confondant énergie et Dieu, même lorsqu’il se dit adepte de la religion cosmique de l’ordre universel range le juif athée dans un autre athéisme.
Il n’existe pas de chrétien athée. Il n’est qu’athée. Toute la différence est là. C’est tout ce que j’ai à dire sur ce vaste sujet.
Synagogue. J’ai connu la synagogue dans ma jeunesse et ne m’y suis jamais ennuyé. Je l’ai délaissée jusqu’à la mort de mon père. Je le regrette. Je pourrais ici, dans des envolées lyriques, décrire un peuple au travail (celui de sa perpétuation matérielle et de « l’aspiration » immatérielle de ce qui est le maître des concepts, puisqu’imprononçable). J’aimerai raconter un office et louer cette communion sans béatitude ni paraître.
Mais je ne veux pas entrer dans cet exercice facile qui me placerait à l’extérieur, dans la vacuité anthropologique, comme je l’ai toujours fait. Il me faut apprendre à m’insérer et les autres sont aussi moi. Ce biais du regard sociologique, cette apologie de l’œil neutre et compétent m’a joué les pires tours dans mon exclusion.
Ce qui nous reste de l’assistance à un office religieux, dans une synagogue dépouillée de l’inutile, est indescriptible, imprononçable, ineffable.
Concentration. La magnifique invention de l’exigence d’un Dieu unique, concentré des forces de l’Univers qui n’est d’ailleurs pas l’apanage du peuple « distingué » mais se retrouve, presque à la même époque (avant même) dans le Paramata des Upanishad indien et dans le sans-nom, toujours indien de la Bhagarad-Gita. Je viens de l’apprendre et me plongerai, très bientôt dans cet univers, obsessionnellement. Abraham = Brahmane ?
Magnifique disais-je. Je suis, en effet, ébloui par cette faculté de penser l’infini et ramasser l’abstrait. Exception humaine ?
Codes, lettres, géométries. L’amour des codes et des secrets à aller chercher au-delà du visible n’est pas le propre du judaïsme, même si l’on peut être tenté par la proposition, en pensant, immédiatement à la Kabbale.
Mais peut-être doit-on trouver assigner une singularité à cette recherche des principes cachés de l’Univers dans la géométrie et le secret des lettres. Ce qui est logique pour le peuple de la Torah, ordonnancement de lettres et mots préexistants à la création du « fini », des hommes.
La création étant construite sur un principe unique, elle ne peut, évidemment qu’initier la recherche.
J’ai découvert, bien sûr dans une lecture indirecte l’énigmatique livre dénommé « Sepher Yetsirah », de chevet pour ceux qui affirment, dans le judaïsme souterrain (toujours en action) qu’un Golem (homme inachevé cependant), donc la vie, peut être créée en manipulant, très exactement et selon un ordre qui est le secret, argile et lettres hébraïques…
J’ai été « invité » (je remercie Ouaknin, Hansel, les auteurs de l’Encyclopédie du judaïsme et bien d’autres encore) à comprendre ce que pouvait être la Kabbale et son premier texte européen, le Zohar sur lesquels l’on reviendra lorsqu’il sera question de réparation du monde imparfait par négligence de Dieu (un comble !)
J’ai été stupéfait par la pratique de la « Guematria » (géométrie) qui s’amuse ( ?) à comparer les mots à leur valeur numérique (chaque lettre de l’alphabet hébraïque a une valeur numérique), de gloser sur la calligraphie desdites lettres. Pages interminables, par exemple sur la lettre « Beth », première de la Torah (première du mot « Béréchit » traduit par « Au commencement… ». Lettre fermée de tous côtés et ouverte seulement par devant pour nous rappeler, disent les guématriens qu’il s’agit de la « maison du monde ». Cette même lettre « Beth » qui peut aussi être traduite comme « En tête » ou mieux « dans la tête » : Dieu avait donc « en tête », dans la tête la création de l’Univers, d’abord pensé. Ce qui devient essentiel dans le faux débat sur l’avant et l’après, sur l’idée et la matière et les primautés originelles. A cet égard, même s’il s’agit d’une déviation dans la logique du propos, j’ai pu découvrir que les traductions peuvent bouleverser un monde. Un exemple : il est dit, après une traduction admise, que Dieu a créé la femme en prenant une « côte » d’Adam. Je viens de lire que rien n’est plus faux. La traduction adéquate est non pas « côte » mais « côté ». Le côté féminin de l’homme.
Si j’ai ajouté cette entrée dans mon petit lexique en vrac, c’est, à dire vrai, pour m’interroger sur l’absence tout aussi énigmatique de procès en sorcellerie intentés à l’endroit de ceux qui s’adonnent à ce travail mystique. Mais peut-être s’agit-il d’une erreur et il faudra me documenter.
Il me semble que les autres religions n’auraient pas admis cette déviation dans la foi agenouillée. Le kabbaliste goy est un sorcier. Obligatoirement puisqu’il ne contemple pas l’image de Marie en se flagellant et ose s’éloigner de sa faute et son péché originel, en arpentant le domaine de Dieu. Sacrilège.
C’est, encore du parti pris que je freine, au risque de provoquer la critique convenue : mon texte s’organiserait autour de l’obsession de l’anti-christianisme.
Mais je préfère la Kabbale à l’Inquisition, l’attaque lettrée du monde à la contemplation, la vaine recherche des principes à celle du « sens » ou de « la spiritualité ».
Et si, dans la même veine, je me permets les comparaisons, ici avec l’hindouisme, comment ne pas évoquer, dans ce paragraphe sur les « secrets » la fameuse « Merkava ».
Il s’agit d’exercices cabalistiques destinés à construire, en faisant tourner les lettres de l’alphabet un « char » céleste qui permettra à Ezéchiel d’atteindre le ciel.
Dans l’Échelle de Jacob, il est affirmé que “les Anges montent et descendent”. Et les “roues de méditation” qui le construisent sont effectivement le maniement des lettres selon un certain ordre et suivant un certain rythme, de plus en plus rapidement, ce qui fait entrer en transe. Plusieurs “roues” permettent de construire un “Merkava”, ce fameux char céleste. J’ai été sidéré d’apprendre que certains y ont vu un ensemble sophistiqué d’exercices respiratoires que les indiens connaissent exactement.
Les religions millénaires se rejoignent dans la modernité.
A cet égard, j’ai appris, dans mes lectures que les américains, férus de bouddhisme, comme chacun sait et de mystique à la chlorophylle ont inventé le mot de « jewbou » pour ramasser les deux postures. On voit qu’il faut se méfier de ces mysticismes.
Mais, je le dis encore, j’aime ces hommes qui, comme des poissons savants, nagent entre les lettres, pour se poser, au fond de la mer, sur le grand rocher de la pensée universelle.
13, 7. La découverte d’un chiffre : 13,7 Millions de Juifs sur la terre. 2/1000 de la population mondiale. On ne commente pas bien sûr. Non pour faire comme si l’on savait, mais simplement parce que la tâche est trop ardue et nous entrainerait dans le politiquement incorrect et un ethnocentrisme dont l’on a déjà dit qu’il ne caractérisait pas le peuple juif.
Israël. Cette entrée n’a pas pour fonction d’exposer mes convictions sur l’histoire du peuple juif et de son Etat. Je veux, simplement dire que je ne connaissais pas l’origine du nom.
Il a donc été donné à Jacob après son combat avec un ange : « tu t’appelleras Israël car tu as combattu avec Elohim, comme avec des hommes ». Et ses enfants furent donc baptisés « enfant d’Israël ». J’avoue n’avoir pas compris ce changement de nom et je retiens simplement, peut-être un peu vite, qu’il suffit de combattre Dieu pour en être honoré.
Israël est donc celui qui se bat contre Dieu. Je m’étonne que les intégristes des autres religions n’en aient pas fait une parabole satanique.
Le dessus du soleil. J’ai recherché quelle était la réponse du judaïsme à la question légitime que se posent tout homme sur l’absence de Dieu et ses conséquences métaphysiques (« si Dieu n’a pu empêcher le Mal, il est impuissant, s’il l’a pu mais ne l’a pas fait, il est barbare »).
Interrogation obligatoire. Mille réponses ont été données par les penseurs juifs et que je ne peux, faute de les avoir bien comprises, répertorier ici. Elles sont, à coup sûr intéressantes et qui convoquent l’homme, sa liberté, sa solitude,.
Il faut, disent maladroitement et du bout des lèvres certains auteurs, aller chercher la réponse «au- dessus du Soleil », par référence au texte du Qotelet (Ecclésiaste). L’action humaine doit lutter contre son inaction, sa répétition, son endormissement au-dessous du soleil où rien de nouveau ne surgit. Et la volonté des hommes est la seule réponse.
Je n’ai pas bien compris.
Homme, Nature, culture. Point nodal des préoccupations humaines, philosophiques si l’on veut. Seule question qui enchaine toutes les autres. Je pars d’une interrogation d’enfant. Lors de mes premières lectures de la Bible, j’avais été stupéfait par le nombre de sacrifices dont la Torah regorgeait, si j’ose dire.
J’avais, comme tous, été choqué par un Dieu qui imposait des sacrifices en son honneur, d’abord celui d’animaux, exactement, géométriquement mis en pièces, puis celui du fils d’Abraham, consenti, mais refusé au dernier moment.
J’ai, sur ce dernier sacrifice été rassuré en apprenant, beaucoup plus tard que par ce refus, Dieu avait, en réalité, consacré l’humain, l’humanité, différente des animaux dont le sacrifice sera, toujours requis. J’avais applaudi à la constitution historique de l’exception humaine.
Je ne savais si l’agneau pascal, abattu, sous mes yeux, dans le garage de la maison de mon oncle, participait de l’exigence d’un sacrifice. Nos trempions nos paumes dans le sang qui s’écoulait sur le sol pour, immédiatement, les plaquer sur le mur d’entrée de la maison.
Je connaissais la signification de cette pratique, rappelée lors de la soirée du « Seder », pendant laquelle nous lisions l’Haggadah (récit de la sortie des juifs d’Egypte). La maison du juif était identifiée par la marque de la paume de sang et Dieu évitait de frapper d’une plaie définitive la demeure de ses protégés, en ne s’attaquant qu’à celle des méchants (les égyptiens).
Tout ceci sonnait, néanmoins, assez faux. Et je préférais éviter le débat sur ce que je considérais comme un récit procédant de l’idolâtrie, de la barbarie, indigne de l’humanité, du judaïsme (que j’ai toujours loué). Je mettais, à cette époque de ma Bar-mitsva, les giclées de sang dans l’histoire révolue. La Bible était datée.
Plus tard, j’applaudissais encore à la nécessité, affirmée dans ma religion, de la domination de la Nature par l’homme. Nature, devant laquelle il ne pouvait, simplement se prosterner. Tout ceci concordait parfaitement avec l’appropriation théorique d’un matérialisme philosophique mal digéré, concomitant, souvent, des premières aventures dans le territoire du concept.
Dans mes premières incursions dans la Théorie, j’ai même tenté d’organiser une « pensée » sur le judaïsme et la Nature, en affirmant l’anti-romantisme des juifs qui préféraient l’action à la fixation sur la beauté. Je crois, sans en être tout à fait sûr, qu’il s’agissait du premier texte auquel je me suis essayé. Je ne l’ai pas gardé et le regrette. C’était, à l’évidence, un tissu d’âneries, mâtiné de matérialisme marxiste naissant. Je magnifiais, dans cette perspective le génie du judaïsme, fondateur de l’exigence de lutte contre la Nature, jamais déifiée. J’insiste : je constate, qu’à aucun moment, dans mes pérégrinations conceptuelles, je n’ai banni le judaïsme, et le convoquais même pour aligner le propos. S’agissant d’un texte où il s’agit aussi de moi, je me devais de m’arrêter sur cette évidence : j’opère bien un retour et non un commencement. On ne commence jamais dans le judaïsme lorsqu’on est juif. Evident.
Donc, la relation du judaïsme à la Nature m’a, toujours interpellé.
Cette notion (la Nature) est floue, eu égard à son acception plurielle. Nature verte, naturante, Nature du monde, Nature spinozienne, Nature romantique, amour de la Nature …
Le mot ne recouvre pas le même signifié, même s’il part de la même réalité.
On peut, sans faire preuve d’invention, dire que deux notions, floues dans notre esprit, s’en dégagent. Ce qui trouble toujours la réflexion non construite et provoque les quiproquos dans les discussions animées sur ce thème.
Celle, philosophique, de la Nature, entendue comme l’étant écologique, structurée, immuable, selon certains, confrontée à la Culture des hommes, exception dans ce que cette Nature donne. A partir de laquelle se fondent le matérialisme des premiers grecs, le panthéisme plus tard, spinoziste, si l’on veut. Nature entendue donc philosophiquement.
L’autre, subjective, dans le champ de l’émotion, de la poésie, de la sensation circonscrite dans le concept de beauté.
Dans cette confusion sur la Nature et sa définition, Je me demandais d’où venait cette indifférence patente de mes parents, oncles, cousins, à ce qui les entourait, et d’abord à la nature éclatante, cette même indifférence à l’animal sauvage ou domestique.
Ne comptaient, en effet, que les hommes. Même les lieux d’une enfance ne comptaient pas. Comme si l’environnement naturel (et même matériel) n’étant qu’un terrain sur lequel l’on joue, l’on souffre, l’on rit. Et j’affirmais que pas un joueur, sauf celui qui est ailleurs, et joue donc mal, ne s’intéresse au terrain de jeu. La philosophie juive de la Nature, celle qui l’exclut pour se concentrer sur les hommes, me convenait parfaitement.
J’ai par la suite tenté de structurer une pensée.
Immense débat qui ramène à Philippe Descola, à Nature /Culture, à la nature de l’homme, à « l’exception humaine ».
Serait-ce que le Judaïsme (Dieu) n’aime pas la nature qu’il doit (c’est un commandement) dominer ?
Serait-ce le succédané de l’interdiction de reproduction (“Tu ne referas aucune image sculptée rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou sous les eaux, ou au-dessous de la terre” Exode XX, 1-4), la beauté non reproductible étant délaissée et remisée dans l’inessentiel ?
Il me semble aussi que la poésie juive n’est jamais (mais je me trompe peut-être, n’étant pas féru de poésie et à fortiori de poésie juive) romantique (au sens de la glorification de la Nature naturante). La fleur embellit et produit des parfums (je viens d’apprendre qu’il existe des prières juives sur les parfums comme sur le vin). Mais la fleur n’est pas autonome et glorifiée dans l’alexandrin. Il ne s’agit que d’un succédané du Monde des hommes, destinée à les servir, pour se souvenir de la beauté du Monde ou satisfaire la jouissance humaine de son parfum et de sa couleur. Ni fleurs du Mal, ni fleurs du Beau (abstrait), le Beau ne pouvant être apprécié que dans sa connivence avec l’action humaine. Et puis le Beau ne se concrétise que dans la réparation du Monde, dans l’action accomplie, conférée disent les exégètes au peuple juif : celle consistant à installer la Justice. Plus belle que la Nature avant de la faire apprécier, le pauvre et l’esclave ne pouvant se contenter de la poésie.
Et pourtant, dira-t-on, le judaïsme célèbre la nature.
Trois grandes fêtes peuvent être reliées à la nature :
Chavouoth : ou la fête des prémices. C’était une fête agricole qui est devenue celle du don de la Torah.
Rosh Adesh : fête de la nouvelle lune qui a disparu jusqu’au XVIIIè siècle où les mouvements hassidiques la tirent de l’oubli.
Chevath : le nouvel an des arbres. On fête le démarrage de la végétation. Elle se situe en général juste au moment de la floraison de l’amandier.
Mais aucune vénération de sa beauté. Plutôt de ses bienfaits. Moïse conduisit le peuple juif dans ce “pays où coulent le lait et le miel”.
De fait, La nature, dans le judaïsme, n’est pas considérée comme bonne en soi. Il y aurait, nous dit-on, désaccord avec la conception grecque de l’humanité en communion avec la nature. On pourrait résumer ce qui précède ainsi : le sage grec cherche la communion avec la nature, tandis que le sage juif cherche ce qu’il y a d’humain dans l’homme.
Dans le genre du mélange (confusion entre Nature, beauté de la Nature et action humaine la désertant, il nous faudra nous intéresser la notion d’exception humaine dans la Torah, manifestement en phase avec « la Thèse », dirait Pierre Schaeffer, c’est certain. Mais sans en rester là : il me faut comprendre la fonction de l’exception humaine, même si elle est construite et sa relation avec l’histoire générale et particulières des juifs. Et, bien sûr sur cette particularité du rapport du même juif à l’art (quasi-absent de son univers, sauf lorsqu’il s’agit d’interpréter l’ouvre du grand musicien rarement juif.). Tout ceci me semble découler d’un même principe que je ne veux ni ne peux ici développer, au risque de me faire traiter par ma femme, toujours en alerte sur mes facilités d’écriture, de rapide théoricien.
Mais je ne peux m’empêcher d’ajouter, puisqu’il s’agit d’exception humaine, quelques mots sur la notion d’homme dans le Judaïsme.
Tout d’abord, l’homme est « incomplet » et doit se réaliser, dans sa personne. C’est ce que rappellent les exégètes en se référant au texte de la genèse. Lorsqu’il crée les êtres non humains, Dieu trouve cela très bien. Il est satisfait de sa production. Mais lorsqu’il crée l’homme, la phrase répétée pour les autres créations (« Dieu vit que cela était bon ») ne vient pas. L’absence de cette locution est cruciale selon les sages : l’homme est inachevé, comme un golem et doit lui-même se parfaire pour se créer complètement. Et c’est sa liberté et son action propre, son « exception ». J’aime cette explication.
Et puis, la Thèse que Pierre Schaeffer démonte dans son grand livre (l’Exception humaine) en unifiant nature et culture ou plutôt en allant au-delà de la dichotomie est au fondement même du judaïsme et il est difficile de s’en extraire, malgré tous nos efforts scientistes. On s’attarde donc, un peu sur le dualisme historico-religieux. En effet, la Bible, à l’inverse de ce que l’on proclame, nie toute dualité entre âme et corps ; L’homme est une synthèse indissociable de l’âme et du corps. Les mots nèfech (âme) et rouah (esprit) désignent la réalité globale de l’être plutôt qu’une partie distincte. Spinoza ne dit pas autre chose, contre Descartes. Le dualisme a, en réalité, été inventé par les rabbins d’ailleurs en contradiction avec eux-mêmes lorsqu’ils affirment que l’homme est un microcosme reflétant la structure entière de l’Univers (« Tout ce Dieu a créé dans le monde, il l’a créé en l’homme »). Matière de la matière pourrait-on dire. La contradiction est flagrante. Mais l’immatériel guette. Ce qui est normal, Dieu étant immatériel. Cependant, s’agissant d’un tout, la distinction matériel/immatériel ne veut plus rien dire comme celle qui dissocié l’âme et le corps ; Et ce d’autant plus que créés à l’image de Dieu, nous ne pouvons être qu’immatériels, comme lui. Il suffirait donc de revenir au Tout (nèfech) pour réconcilier les concepts. Nominalisme encore. Sartre, dans une envolée stupide, comme il en a le secret, aurait pu dire que l’immatériel précède la matière qui est elle-même immatérielle. Et le tour serait joué.
Et si nous faisions un tour de côté de la Kabbale, on découvrirait que la “nature” n’existe pas véritablement ; ce qui existe vraiment, c’est la “hiyout”, la vitalité qui anime la nature de l’intérieur. Le but de l’homme dans le monde est de découvrir la “pnimiout”, l’intériorité des choses et leur sens véritable. Mais il est ici question de nature, semble-t-il, et non de nature naturante.
Mais abandonnons ces vaines digressions oiseuses et fumeuses, buées de fumées, et tournons la tête pour regarder notre chat sans âme et pourtant bien beau, même s’il vient de voler une cuisse de poulet sur la table, ce qui mérite la lapidation (cf Tsedaka).
Métaphores de construction. Une réponse à l’interprétation primaire et créationniste et aux interrogations légitimes sur l’incompatibilité entre Science et récit biblique (genèse) de la création de l’Univers et de l’homme. Je viens, en effet, dans mes lectures récentes de découvrir une réponse juive, fondée, comme nous y invite d’ailleurs, toujours, Maimonide pour la lecture de la Torah, sur la métaphore. Certes, tous savent qu’il ne s’agit que d’une métaphore, sauf les intégristes et les idiots. Mais des scientifiques (juifs semble t-il) rappellent que ce dit la Bible est parfaitement exact. Six jours pour faire le Monde. En réalité six époques et qui coïncident parfaitement, dans leur chronologie, avec ce que nous dit la science : l’homme est apparu le « sixième jour » après la lumière, le ciel, la terre, les étoiles, les animaux. Comme décrit dans la genèse biblique. Faux débat au demeurant si l’on considère que le vrai n’a rien avoir avec la religion, que la métaphore dont l’expression la plus achevée est celle d’un Dieu abstrait et non représentable l’emporte sur la littéralité des écrits (Notons ici, pour ceux qui l’auraient oublié qu’il existe quatre niveaux de lisibilité des textes biblique : littéral, symbolique, interprétatif, mystique. Je renvoie le lecteur à une recherche de la signification desdits niveaux).
Je ne peux, dans ce bavardage, m’empêcher ici de faire allusion à cette fascinante théorie mise en forme au XVIème siècle par le kabbaliste Isaac Luria (dit « Le Lion »), théoricien du retrait de Dieu et de la solitude de l’homme et qui nous a écrit « le Livre du Secret », résumé par MA Ouaknin, (Le Livre Brûlé, Editions du Seuil 1994, Collection sagesse, pages 391 et 382) dans ces termes
“Après le Tsimtsoum, la lumière divine jaillit dans l’espace vide sous forme de rayon en ligne droite. Cette lumière se nomme Adam Kadmon, c’est-à-dire, l’Homme primordial”.
Adam Kadmon n’est rien d’autre qu’une première figure de la lumière divine qui vient de l’essence de l’En-Sof (in-fini) dans l’espace du premier Tsimtsoum, non pas de tous côtés, mais comme un rayon dans une seule direction. Au départ, les lumières émanées étaient équilibrées (Or vachar veor hozère), puis les lumières qui jaillirent des yeux de l'”Homme Primordial” émanèrent selon un principe de séparation, atomisées ou punctiformes (olam hanequoudim). Ces lumières furent contenues dans des vases solides. Quand ces lumières émanèrent par la suite, leur impact se révéla trop fort pour leurs récipients qui ne purent les contenir et, de ce fait, éclatèrent. La majeure partie de la lumière libérée remonta à sa source supérieure, mais un certain nombre d’étincelles demeurèrent collées aux fragments des récipients brisés. Ces fragments, de même que les étincelles divines qui y adhéraient, “tombèrent” dans l’espace vide. Ils y donnèrent naissance à une moment donné au domaine de la Qlipa que la terminologie cabaliste nomme l'”autre côté”.
La brisure des vases introduit dans la création un déplacement. Avant la brisure, chaque élément du monde occupait une place adéquate et réservée; avec la brisure, tout est désarticulé. Même les Sephiroth, dont les récipients auraient dû recevoir l’influx supérieur de lumière et transmettre – selon les lois de l’émanation – aux niveaux d’êtres inférieurs, ne se trouvèrent plus à leur place. Tout est désormais imparfait et déficient, en un sens “cassé” ou “tombé”. Toutes les choses sont “ailleurs”, écartées de leur place propre, en exil…
On comprend alors le sens du troisième moment du processus lourianique : le Tiqqun; il s’agit de restaurer, de réparer la brisure, d’une certaine manière de retrouver et de situer toute chose à sa place : c’est le rôle de l’homme; là est son histoire.”
Tikkun Olam. Réparation du monde. Pour ceux qui s’en souviennent, j’en avais fait un roman, mauvais, non publié, partant de la métaphore pour la plaquer bêtement sur des « rencontres réparatrices ». Tellement mauvais que, depuis, j’ai du mal à me remettre à l’écriture. Ce qui se lit.
Une formidable et énigmatique approche de la création du monde (vases qui structurent l’Univers, métaphore incroyable de l’espace- courbe d’Einstein, contraction de l’univers…)
On s’intéressera plus tard à cette vision de « la Kabbale lourianique » (retrait de Dieu, étincelles, traces qui en se regroupant constituent « le Mal » lequel empêche les autres étincelles libres de rejoindre la lumière divine dont elles font parties, dérèglement, travail de réparation à accomplir, aide de Dieu, par les hommes à réparer sa négligence ou son erreur dans le processus de création par la lutte contre le Mal, choix du peuple juif par Dieu pour l’aider à réparer, commandements destinés à réparer, actions des plus modestes dans cette réparation, et réunion de l’ensemble des actions pour la réparation finale. Chaque homme est une étincelle de Dieu et l’action collective est la seule qui vaille nous dit-on, somme des petites qui la dépasse, en se constituant en force cosmique). Ouf…
Construction éblouissante qui, en l’état, nous fait nous interroger sur ce qui était notre propos : la métaphore et la science. Facile de trouver les convergences mais l’homme a certainement besoin de cette science poétique (ou de cette poésie scientifique, comme on voudra) pour avancer, dans la certitude que le grand principe est à découvrir..
Lettre de la Loi. Il serait vain et idiot de commenter le mot, tant il est au fondement de ce qui se trame dans le Judaïsme. Je note, ici, simplement, que les sages ajoutent qu’il « faut aller au-delà de la lettre de la Loi » (lifrim mi-chourat ha-din). Justice tempérée par la miséricorde, vérité par la bonté, rigueur de la Loi par la compassion. On ne saurait mieux dire. Sauf à ajouter, que miséricorde, bonté et compassion font partie de la Loi. Ou plutôt de l’Universel. Et qu’Antigone est biblique.
Electron libre créateur. L’hésitation de Dieu à créer Adam. Il consulte les anges. Son inquiétude après ce travail. Homme libre, électron libre, qui, dans sa liberté peut ne plus le satisfaire. Dieu quantique. Homme à l’image de Dieu, créateur, comme Dieu. Qui se crée lui-même et qui peut donc se transformer…
Ici, j’introduis ce qui est violence à l’égard de tout ce que j’ai crié, dès la première découverte d’une pensée et tout au long de ma tentative de manier l’outil philosophique, entrainé d’abord par un Spinoza, certainement mal lu, puis par les Foucault, Althusser et autres assassins du sujet : il n’existe pas, au sens ontologique du terme (dans sa plénitude, sa prétendue conscience libre, faiseuse d’Histoire.
Le judaïsme est à l’opposé, semble-t-il de cette homme ravalé à son mécanisme sans volonté. Le judaïsme est autant une croyance en l’homme, créateur à l’image de Dieu qu’un anti-platonisme qui fait la part entre l’essence divine et l’illusion terrestre, entre « l’en-haut » qui gouverne et « l’en-bas » des hommes qui subissent, tragiquement.
C’est Levinas qui nous rappelle ce qui constitue une véritable inversion : Dieu, dans son histoire, et même son « destin » dépend des hommes ! Il les a fait à son image pour qu’ils puissent arriver à cette perfection dans l’élan permanent de leur création continuelle, hommes non parfaits (on se rappelle que Dieu n’était pas satisfait de la création ce cet humain, comme il l’a été des cieux et de la lumière).
Responsabilité lourde, très lourde des humains, à l’égard de l’Histoire du monde qui inclut Dieu. Et donc, ici, l’instauration d’un sujet même pas transcendantal, simplement comptable de ses actions dans la fabrication du monde ‘ou sa réparation selon Louria. (Cf kabbale lourianique et lien entre le divin et le terrestre dans le mouvement cabalistique des sephirot.)
Transgression initiale. Le couple, essentiel et récurrent, dans le Judaïsme entre transgression et repentance. D’abord transgresser (c’est un quasi-commandement puisque Dieu admet cette déviation) et la repentance, qui le met parmi les hommes. En hébreu : Ever et Techouva. L’action n’est faite que de cela. Loin des limbes de la contemplation. Loin de la terreur, loin du péché. A des années lumière des agenouillements.
Première sortie avant celle d’Egypte. La bonne nouvelle pour Dieu, selon les exégètes hardis, lorsqu’Adam croque le fruit défendu. Il s’évade du vide, de l’ennui (Jardin d’Eden, enfer de l’ennui), de la répétition, entre dans le temps, travaille et rencontre les autres, et peut ainsi « réparer » le monde, en aidant les mêmes. Bien vrai. Si Adam n’avait pas croqué la pomme, nous serions des légumes. La femme nous a sauvés, mais Dieu l’avait déjà « en tête », cette sortie dans l’histoire. En réalité, et la chose revient toujours : comment peut-il juger ce qui était en germe, qui est de l’histoire qu’il génère. La liberté de l’homme est celle de Dieu.
La terre ferme, en-deçà. L’absence de théorie unifiée sur l’au-delà, loin de la terreur, certains théologiens juifs le niant absolument, d’autres confinant les âmes dans une simple « demeure des morts » pas très gaie et sans attrait, d’autres, encore (Talmud), plus proches du classicisme ambiant, affirmant l’existence pour les Justes d’une vie dans l’Eden et son jardin, loin des méchants qui n’y accèdent pas (« le monde terrestre est comme un vestibule menant au monde à venir, prépares- toi dans ce vestibule afin de pouvoir entrer dans la salle du Banquet ». Rabbi Yaacov. Avot 4, 16).Et le Kaddish, celui que je récite désormais régulièrement pour honorer mon père qui aide les morts à entrer dans ce paradis, en araméen, pour piéger les mauvais anges qui ne le comprennent pas…
D’autres croient à la réincarnation (« Gilgoul »), proches des indiens (Inde). Mais il ne s’agit pas d’une doctrine officielle. Et pour cause, ce peuple de l’unité concentrée ne s’est pas donné une papauté unificatrice du dogme. Ce qui est un comble.
Synthèse. On a pu dire que le juif « aimant à voyager léger adore la synthèse ». Etant observé que l’on pourrait tout aussi bien dire que le juif étant simple, lorsqu’il n’est pas kabbaliste ne peut entendre que la simplicité, à la limite de la banalité érigée en principe, à l’usage des simples d’esprit (n’a-t-on pas entendu dans la bouche des grands antisémites que si Dieu avait choisi le peuple juif, c’est uniquement parce qu’il était le seul à pouvoir entendre et se conformer aux inepties ?). Faux, absolument et évidemment faux, jaloux et antisémite. Malgré les dénégations de certains proches sur ce que j’affirme depuis qu’il m’a été donné de penser, le juif est le maître de l’abstraction, de la pensée ramassée, sans images ni béquilles, celle qu’il ne faut pas confondre avec son succédané qu’est la théorie, rebondissant sur ce sol élastique de l’abstraction, pour se perdre dans l’inutile.
Le juif adore, ainsi, le résumé (Dieu est un résumé des forces et la Torah un résumé de Dieu). Et j’ai pu être frappé par les formules définitives qui ramasse des milliards de mots et des millions de pages qui scandent les textes sacrés (« Pour exister, le monde a besoin de la Loi, de la pratique, de la Justice »).
Corps en émoi. Cantique des cantiques. Hymne à la sexualité, malgré ses traductions éthérées, glorification de l’amour physique, sans procréation obligée. Vie qui se doit d’être vécue radicalement, don qu’il serait indigne de ne pas profiter. Ici, l’on pourrait cependant s’interroger sur la pudeur du juif (la vision de la nudité du père ou du fils étant sacrilège) et cette affirmation de la sexualité. On ne le fait pas, pour les mêmes raisons (la glose facile et l’enterrement de la notion sous les oripeaux théoriques. On y reviendra plus tard, lorsque les démons de l’analyse se rappelleront à mon souvenir, inéluctablement.
Tsedaka, rectitude. Justice. Ou encore « rectitude ». Traduction plus conforme, la Loi ne pouvant être, comme dans les Lumières, générale et abstraite, mais concrète, en action, au travail. Et la rectitude d’un homme veut dire mieux ce que peut être la Tsedaka.
Concept central, merveilleux à qui s’y réfère dans son quotidien. Justice au profit de ceux qui souffrent, sans que la souffrance ne soit pas magnifiée, le scandale étant la pauvreté et non la richesse. Aide qui ne peut se contenter de charité et de compassion mais qui doit se poursuivre jusqu’à l’autonomie de celui que l’on aide. Tsedaka indigne lorsque l’on ne fait que donner, chose facile, une partie infime de son patrimoine pour prétendre au sommeil sans cauchemars. Balivernes de village. Tsedaka qui est accomplir lorsque le pauvre ou le chômeur pourra assumer sa vie. Ne pas simplement donner mais organiser l’environnement. Banalité s’il en est mais bonne à rappeler. Rien ne se passe à la sortie de l’Eglise, la sébille étant un leurre. Imaginons, enfin, que l’on se rende à la cinquième chambre du « Palais de la Rectitude ». La nuque serait roide. Les mots, encore les mots.
Mais, il nous faut nous éloigner de la vision idyllique de la Justice dans le Judaïsme, même si la prononciation du mot « Tsedaka » donne une toute autre allure, par sa magie de l’étrange, à la rectitude obligée car, comme on le sait, les textes bibliques contiennent des « commandements » cruels qui se doivent d’être rappelés, même si le contexte historique peut les justifier, que les sages ont vite expliqué, pour les remiser rapidement dans le champ de la métaphore ou de la parabole. Il en est un qui m’a frappé : celui du « fils rebelle » qui non seulement conteste l’autorité paternelle mais le vole. Il est dit qu’il faut le mettre à mort après lapidation. Et la disproportion de la peine interpelle nos âmes sensibles. On va chercher dans les textes et l’on découvre que la Loi énonce « Faites le mourir innocent et non mourir coupable ». Ce fils rebelle qui a osé voler son père pourrait, en effet, devenir un bandit de grand chemin ou un criminel tant ses premières déviations sont gravissimes. Et il vaut mieux, immédiatement, arrêter son périple infâme…Il est vrai que cette jurisprudence a été écartée et que l’on s’en remet désormais, dans un Tribunal rabbinique, à la discrétion des juges, étant observé que cette règle n’a jamais fait partie des 613 commandements que le juif doit respecter.
Je regrette, à vrai dire d’avoir ajouté cette anecdote dans la rectitude et être passé du général au particulier. Oubliez-la et prononcez le mot « Tsedaka » qui sonne dur et doux.
Pour finir sur cette rectitude, je ne résiste pas (encore…) à insérer une petite histoire qui est autant un jeu de mots que le rappel de la rectitude (tout le judaïsme):
C’est l’histoire de David et Moshe, deux cousins très liés. Au moment de mourir, David appelle son cher cousin à son chevet et lui lègue sa fortune. ” Cependant, lui annonce-t-il, je te demande une chose : va voir ma pauvre femme, donne-lui l’argent que tu veux et garde le reste pour toi. ” Moshe exécute ses dernières volontés : il garde 3 millions de dollars et donne 30 000 dollars à la veuve. Mais, quelque temps après, celle-ci va voir le rabbin et se plaint du peu d’argent reçu. Le rabbin va parler à Moshe : ” Moshe, qu’as-tu fait de la fortune de David ?
— J’ai fait comme il m’a dit, répond Moshe. David m’a dit : “Donne ce que tu veux et garde le reste pour toi.”
— Ce que tu veux ! s’exclame le rabbin. Qu’est-ce que tu veux, Moshe ?
— Eh bien, 3 millions de dollars !
— Alors, “ce que tu veux”, 3 millions de dollars, donne-le à la veuve… et garde “le reste”, 30 000 dollars, pour toi, dit le rabbin. Voilà ce qui est juste. ”
Chekina, présence du tout. Encore de l’abstrait. Présence abstraite, immanente, « halo de lumière » selon Maimonide. Dieu est partout (même si le proverbe yiddish prétend que ne pouvant être partout, Dieu a créé les mères…). Partie féminine de Dieu, selon le Zohar. Présence qui suit le juif partout, envahissante, exigeante. Absolu présent dans le quotidien et lutte contre la solitude de l’homme. Toutes les religions, évidemment, s’en emparent, pour la qualifier de foi ou pour, encore, magnifier la présence mystérieuse de Dieu, brume du merveilleux. Le judaïsme ne la conçoit cependant que comme une extériorité, en dehors de la communion et de la prostration béate. Extérieur qui enveloppe, au-delà de la pensée de son existence ou de son enveloppement et qui devient inhérente. Et Spinoza, comme les indiens nous l’exposent. (On sera obligé de revenir sur Spinoza et le Judaïsme, objet d’une autre « obsession ». On comprend et on ne comprend pas, tant Spinoza que le Tribunal rabbinique qui l’a exclu et non répudié. Mais je crois que je confonds Chekina et panthéisme de foire…)
Ecoute ! C’est le premier mot du Chema : « Ecoute Israël, le seigneur est notre Dieu, le seigneur est Un ». D’abord écouter. Difficile, nous dira-t-on dans son interprétation primaire (le mot d’esprit du Dimanche). En réalité, un rappel à l’ordre pour ne jamais se perdre. Ecoute comme tu es vivant. Rien d’autre.
Devant du désert. Extraordinaire que ce concept de désert dans lequel errent les juifs avant de trouver la terre promise. Dans lequel, malgré sa beauté, malgré le repos de la parenthèse, il ne faut pas se complaire. Désert temporaire qu’il faut absolument quitter, pour échapper à la répétition, le vide, l’inaction, la contemplation, ennemie des hommes et de leur mission. Avancer, avancer…
Tolérance. Ici, on est en droit de crier à l’imposture. Comment affirmer l’esprit de tolérance dans le Judaïsme alors qu’il exclut les « gentils » et exige des règles de vie contraignantes, exclusives de toute interprétation subjective. On fait. Point, c’est tout. On comprend après, si on le veut, par l’Etude. Totalitarisme diront la majorité, absorption de la liberté dans la norme rigide et absolue, loin de la tolérance, synonyme de liberté. Première approche qui fût la mienne.
Pourtant inexacte épistémologiquement. En effet, et tout d’abord, le choix est donné, sans anathème, ni procès de Torquemada (ce qui est déjà énorme).
Ensuite, il faut, parait-il, lire le Talmud : l’opinion des minoritaires y est exposée et la dernière interprétation ne vaut que pour celle qui suit ou suivra. Le « dernier mot » n’appartient à personne, même si pour des besoins compréhensibles (la loi de la majorité), la règle est édictée. Je ne crois pas que les chrétiens, au 12ème siècle, auraient pu tolérer un théologien comme Ibn Ezra qui remettait radicalement en cause le dogme, allant jusqu’à crier que la Torah était l’œuvre des hommes et pas de Dieu, abstraction qui n’écrit pas et dont Maimonide disait qu’il fallait le respecter cet Ezra, parce qu’il pensait sans complaisance. Les juifs ne connaissent pas le bûcher, sauf lorsqu’ils y sont jetés. Et la guerre de religion ne les concerne pas.
Il n’est pas inutile, ici de faire référence à l’Ecclésiaste (Qohelet). J’avoue avoir été fasciné par ce texte d’un pessimisme exacerbé et dont l’on se demande comment les théologiens juifs l’ont admis dans le corpus des textes sacrés. Tout se passe comme s’il s’agissait d’une contre-torah. Incroyance latente. Tout est vain, tout n’est que « pâture de vent, buée, fumées ». Rien de nouveau sous le soleil. Et donc, jouissance de l’instant glorifiée. Consommation de plaisir exigée. Les rabbins ont donc intégré dans la Bible ce texte nietzschéen, ce tract soixante-huit-art. Tolérance, certes. Mais, selon d’autres rabbis, un rappel de l’exigence d’aller, justement « au-dessus du soleil », par la brisure de la routine et le changement de son monde. Et, partant, du monde. Mission confiée aux « distingués ».
Credo. Je dois à Georges Hansel (De la Bible au Talmud. Ed Odile Jacob) de merveilleuses heures de lecture. Je donne ici une bribe de son apport. Analysant la différence entre les trois monothéismes, il rappelle qu’à l’inverse de la doxa, Abraham n’est aucunement le père des trois religions, le père des croyants, comme le proclame d’abord chrétiens et musulmans. Car, dit-il, de manière lumineuse, « conditionner le divin par le prononcé d’un credo, d’une profession de foi ou d’un dogme n’est rien d’autre qu’un détournement de l’héritage d’Abraham, détournement opéré aussi bien par le christianisme que par l’Islam, convergents sur ce point. Les conséquences de cette convergence, nous les connaissons bien : ce sont les guerres de religion……Abraham est le père de ceux qui refusent les mystifications….le père d’une pensée rationnelle, il est le père des savants et non un fondateur de religion…le père de ceux qui aspirent à la Justice… »
C’est par là que je conclus. Et confirme mon parti pris.
Père et emphase
Je termine ce texte, imparfait et naïf, en pensant à mon père, dans une salve emphatique que, décidément, je ne peux remiser. Mon père à qui je dois ce bref plongeon dans ce qui fût les fondements de son action, apnée qui se veut l’honorer. J’aurais aimé lui adresser ces lignes, vite jetées sur un écran, certainement billevesées de celui qui découvre ou commence. J’aurais aimé parler avec lui, ce que je n’ai jamais fait, certain de la justesse d’une pudeur obligée. Je le regrette quand je pense à ses yeux envahis par mille soleils, dès qu’il s’agissait de penser et chercher, jusque sur son lit d’hôpital, lorsque nous entamions une discussion. Mille étincelles au milieu de celles qui réparent le monde. Père, laisse-moi te remercier.







 Les très-bien-pensants sortent presque leurs revolvers lorsque le nom de Chantal Delsol apparait quelque part.
Les très-bien-pensants sortent presque leurs revolvers lorsque le nom de Chantal Delsol apparait quelque part. Le Samedi matin, c’et donc Finkielkraut. Et Finkielkraut, comme beaucoup, dès qu’il s’agit de rappeler ce qu’est une identité, une nation pour dire juste, convoque Ernest Renan ((1823-1892).
Le Samedi matin, c’et donc Finkielkraut. Et Finkielkraut, comme beaucoup, dès qu’il s’agit de rappeler ce qu’est une identité, une nation pour dire juste, convoque Ernest Renan ((1823-1892).



 Le titre est curieux. On dirait une annonce de vente d’une automobile de marque Renault, aux noms compliqués, choisis par des publicitaires savants et accrocheurs..
Le titre est curieux. On dirait une annonce de vente d’une automobile de marque Renault, aux noms compliqués, choisis par des publicitaires savants et accrocheurs.. Personne ne va me croire. Et pourtant j’affirme (c’est le cas de le dire) que c’est la pure vérité.
Personne ne va me croire. Et pourtant j’affirme (c’est le cas de le dire) que c’est la pure vérité.
 Dans L’Art du roman, Milan Kundera écrit:
Dans L’Art du roman, Milan Kundera écrit: Dans son excellent ouvrage sur l’immense Lucrèce que nous citons souvent ici (
Dans son excellent ouvrage sur l’immense Lucrèce que nous citons souvent ici (

 Le précédent billet, sur la morale et son caractère inné, m’a fait revenir sur les neurones miroirs.
Le précédent billet, sur la morale et son caractère inné, m’a fait revenir sur les neurones miroirs.







 J’ai toujours l’appréhension d’être pris pour le pédant de service lorsque je rappelle ce que j’ai, simplement, pu apprendre sur des bancs ou dans des livres.
J’ai toujours l’appréhension d’être pris pour le pédant de service lorsque je rappelle ce que j’ai, simplement, pu apprendre sur des bancs ou dans des livres.
 C’est évidemment après une ou deux pages que l’on décèle la qualité du bouquin qu’on vient d’acheter (pour ce qui me concerne, sauf indisponibilité sous le format numérique, pour mille motifs).
C’est évidemment après une ou deux pages que l’on décèle la qualité du bouquin qu’on vient d’acheter (pour ce qui me concerne, sauf indisponibilité sous le format numérique, pour mille motifs).

 Retour. Conversation hier avec un “ami” de très longue date que j’ai retrouvé après des décennies. Joyeux de ces retrouvailles et pourtant la discussion a porté sur la “méchanceté”.
Retour. Conversation hier avec un “ami” de très longue date que j’ai retrouvé après des décennies. Joyeux de ces retrouvailles et pourtant la discussion a porté sur la “méchanceté”.

 J’avais dans un précédent billet précisé, ce qui peut parfaitement n’intéresser personne, que je m’étais attelé à la lecture d’un vrai bouquin, loin des billevesées d’apprentis écologistes écrit par le grand
J’avais dans un précédent billet précisé, ce qui peut parfaitement n’intéresser personne, que je m’étais attelé à la lecture d’un vrai bouquin, loin des billevesées d’apprentis écologistes écrit par le grand 






 C’est à l’arrêt, devant un feu rouge trop long qu’on m’a posé la question de savoir où trouver un résumé clair et fécond de la pensée de Spinoza.
C’est à l’arrêt, devant un feu rouge trop long qu’on m’a posé la question de savoir où trouver un résumé clair et fécond de la pensée de Spinoza. On ne lasse pas de lire les pensées de Pascal et sa page tirée du fond d’une écriture presque divine sur l’homme dans l’infini.
On ne lasse pas de lire les pensées de Pascal et sa page tirée du fond d’une écriture presque divine sur l’homme dans l’infini.
 Rien ne vaut un bonne bière friche. Et l’on constate, aux terrasses de café qu’il s’agit (à par l’idiot cocktail Pritz à la mode et mauvais) qu’il s’agit de la boisson la plus consommée.
Rien ne vaut un bonne bière friche. Et l’on constate, aux terrasses de café qu’il s’agit (à par l’idiot cocktail Pritz à la mode et mauvais) qu’il s’agit de la boisson la plus consommée.



 Le « je sais que je ne sais rien », la citation la plus connue de Socrate est assez exaspérante, puisqu’aussi bien, il y des choses que je sais, que nous savons.
Le « je sais que je ne sais rien », la citation la plus connue de Socrate est assez exaspérante, puisqu’aussi bien, il y des choses que je sais, que nous savons.
 On dit de Fernando Pessoa qu’il a concentré dans son œuvre, avant tous, les « problématiques du XX e siècle” qui seraient, selon des analystes rapides et répétiteurs, beaucoup sartriens, le moi, la conscience et la solitude; que tous ses écrits les “affrontent”.
On dit de Fernando Pessoa qu’il a concentré dans son œuvre, avant tous, les « problématiques du XX e siècle” qui seraient, selon des analystes rapides et répétiteurs, beaucoup sartriens, le moi, la conscience et la solitude; que tous ses écrits les “affrontent”.
 Une amie (si l’on veut) férue d’auteures anglaises et tenant Jane Austen pour plus grande que Virginia Woolf m’a entrepris aujourd’hui sur la souffrance et la douleur. Thème assez récurrent chez ces écrivaines.
Une amie (si l’on veut) férue d’auteures anglaises et tenant Jane Austen pour plus grande que Virginia Woolf m’a entrepris aujourd’hui sur la souffrance et la douleur. Thème assez récurrent chez ces écrivaines. Rien n’est plus facile, autour d’une table envahie par les commentateurs de service, teneurs inutiles de discours médiocres sur ce qu’ils n’ont pas lu, assez incultes, qui agitent leur verre de vin qui vient tâcher une chemise en lin, savamment froissée, que de critiquer Régis Debray.
Rien n’est plus facile, autour d’une table envahie par les commentateurs de service, teneurs inutiles de discours médiocres sur ce qu’ils n’ont pas lu, assez incultes, qui agitent leur verre de vin qui vient tâcher une chemise en lin, savamment froissée, que de critiquer Régis Debray. L’autre soir, devant une eau-de- vie de figues de premier choix (carte noire) une amie, écrivaine, ce qui est donc plus qu’un écrivant, a conseillé à un attablé d’écrire son moment présent assez inédit, presque époustouflant, improbable. Vantant sa plume qu’elle qualifiait de “force sidérale”; elle affirmait que “son temps” actuel, relaté dans son talent, ferait un roman presque du siècle.
L’autre soir, devant une eau-de- vie de figues de premier choix (carte noire) une amie, écrivaine, ce qui est donc plus qu’un écrivant, a conseillé à un attablé d’écrire son moment présent assez inédit, presque époustouflant, improbable. Vantant sa plume qu’elle qualifiait de “force sidérale”; elle affirmait que “son temps” actuel, relaté dans son talent, ferait un roman presque du siècle.









 “Rien ne vient de rien”.
“Rien ne vient de rien”.




 Les dernières études comportementales, très sérieuses, prétendent que les connectés ne veulent plus faire l’effort, lorsqu’ils sont sur un site, de la recherche du contenu par le traditionnel”menu”.
Les dernières études comportementales, très sérieuses, prétendent que les connectés ne veulent plus faire l’effort, lorsqu’ils sont sur un site, de la recherche du contenu par le traditionnel”menu”.






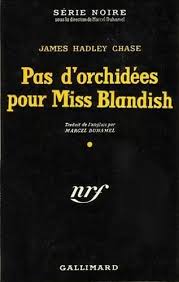 Le temps est donc, comme souvent lorsque le dernier bouquin vous tombe des mains, à la relecture. Il faut toujours relire. Ca nous fait voyager dans une vie. La sienne évidemment. La bibliothèque dans sa liseuse ou sa tablette est, pour ce faire, prodigieusement au point.
Le temps est donc, comme souvent lorsque le dernier bouquin vous tombe des mains, à la relecture. Il faut toujours relire. Ca nous fait voyager dans une vie. La sienne évidemment. La bibliothèque dans sa liseuse ou sa tablette est, pour ce faire, prodigieusement au point.












 La soirée s’annonçait bien, tous souriaient, allez savoir pourquoi. De fait la soirée se déroulait bien. L’un des invités proposa un jeu. Il s’agissait, pour chacun, de raconter sa “vie antérieure”. C’était,avait-il dit, une manière de raconter son humeur. Soit une vie atroce dont on s’était libéré par une vie présente extraordinaire. Soit une vie de rêve comparée à celle que le narrateur subit.
La soirée s’annonçait bien, tous souriaient, allez savoir pourquoi. De fait la soirée se déroulait bien. L’un des invités proposa un jeu. Il s’agissait, pour chacun, de raconter sa “vie antérieure”. C’était,avait-il dit, une manière de raconter son humeur. Soit une vie atroce dont on s’était libéré par une vie présente extraordinaire. Soit une vie de rêve comparée à celle que le narrateur subit.






 Quelquefois les archives nous aident à revenir à l’essentiel. Nous voilà, dans un vieux disque dur, à la recherche d’un texte paru dans le Monde des Livres, à l’époque où je lisais encore ce journal, version papier, que mon ami le kioskiste déposait, dès son arrivée, vers 13:35 au pied de ma porte.
Quelquefois les archives nous aident à revenir à l’essentiel. Nous voilà, dans un vieux disque dur, à la recherche d’un texte paru dans le Monde des Livres, à l’époque où je lisais encore ce journal, version papier, que mon ami le kioskiste déposait, dès son arrivée, vers 13:35 au pied de ma porte.













 Pour répondre au titre, il me semble, dans un premier temps de coller ci-dessous un extrait que Françoise Héritier (elle a rencontré l’ethnologie en même temps que l’enseignement de Claude Lévi-Strauss, auquel elle a succédé à la tête du Laboratoire d’anthropologie sociale. Elle est décédée en 2017) a accordé en 2008 à Nicolas Journet :
Pour répondre au titre, il me semble, dans un premier temps de coller ci-dessous un extrait que Françoise Héritier (elle a rencontré l’ethnologie en même temps que l’enseignement de Claude Lévi-Strauss, auquel elle a succédé à la tête du Laboratoire d’anthropologie sociale. Elle est décédée en 2017) a accordé en 2008 à Nicolas Journet :












 Mr Christophe Castaner, Ministre de l’intérieur, a donc reçu à diner, ce 11 Février, les représentants des principales obédiences maçonniques françaises.
Mr Christophe Castaner, Ministre de l’intérieur, a donc reçu à diner, ce 11 Février, les représentants des principales obédiences maçonniques françaises. 


 Désormais, lorsqu’on demandera quel est le chef d’œuvre d’Albert Cohen,, il suffira de répondre Solal et les Solal en montrant ce Quarto. Même si, comme le rappelle Me Karine Jacoby, son chef d’œuvre dans l’ordre de la non-fiction demeure le passeport des réfugiés. Car lorsqu’il n’écrivait pas, il était diplomate à la Société des nations à Genève. Et c’est ès-qualités, en tant que conseiller juridique au Comité intergouvernemental ad hoc, qu’il élabora l’accord international portant sur le statut et la protection des réfugiés (15 octobre 1946), lequel remplaça le passeport Nanssen. Preuve s’il en est, selon Philippe Zard, qu’Albert Cohen appartient à la catégorie d’écrivains qui placera toujours l’éthique au-dessus de l’esthétique.
Désormais, lorsqu’on demandera quel est le chef d’œuvre d’Albert Cohen,, il suffira de répondre Solal et les Solal en montrant ce Quarto. Même si, comme le rappelle Me Karine Jacoby, son chef d’œuvre dans l’ordre de la non-fiction demeure le passeport des réfugiés. Car lorsqu’il n’écrivait pas, il était diplomate à la Société des nations à Genève. Et c’est ès-qualités, en tant que conseiller juridique au Comité intergouvernemental ad hoc, qu’il élabora l’accord international portant sur le statut et la protection des réfugiés (15 octobre 1946), lequel remplaça le passeport Nanssen. Preuve s’il en est, selon Philippe Zard, qu’Albert Cohen appartient à la catégorie d’écrivains qui placera toujours l’éthique au-dessus de l’esthétique.











 « Sagesse », de Michel Onfray
« Sagesse », de Michel Onfray



















 En ce jour de réveillon de Noël, Il n’est pas inutile de revenir sur le beau texte de Claude Lévi-Strauss, que, curieusement, peu connaissent..
En ce jour de réveillon de Noël, Il n’est pas inutile de revenir sur le beau texte de Claude Lévi-Strauss, que, curieusement, peu connaissent.. Claude LÉVI-STRAUSS.
Claude LÉVI-STRAUSS.



